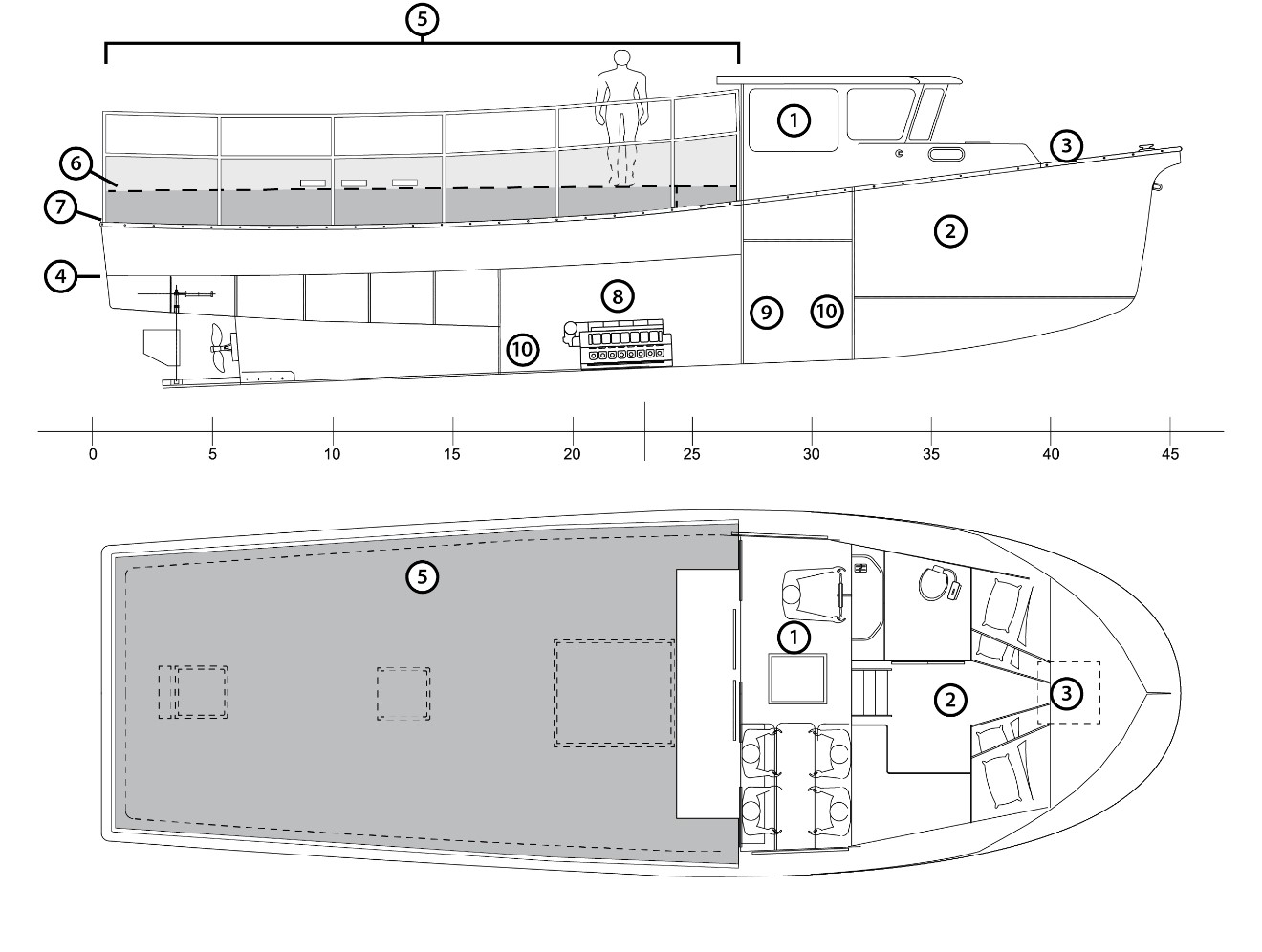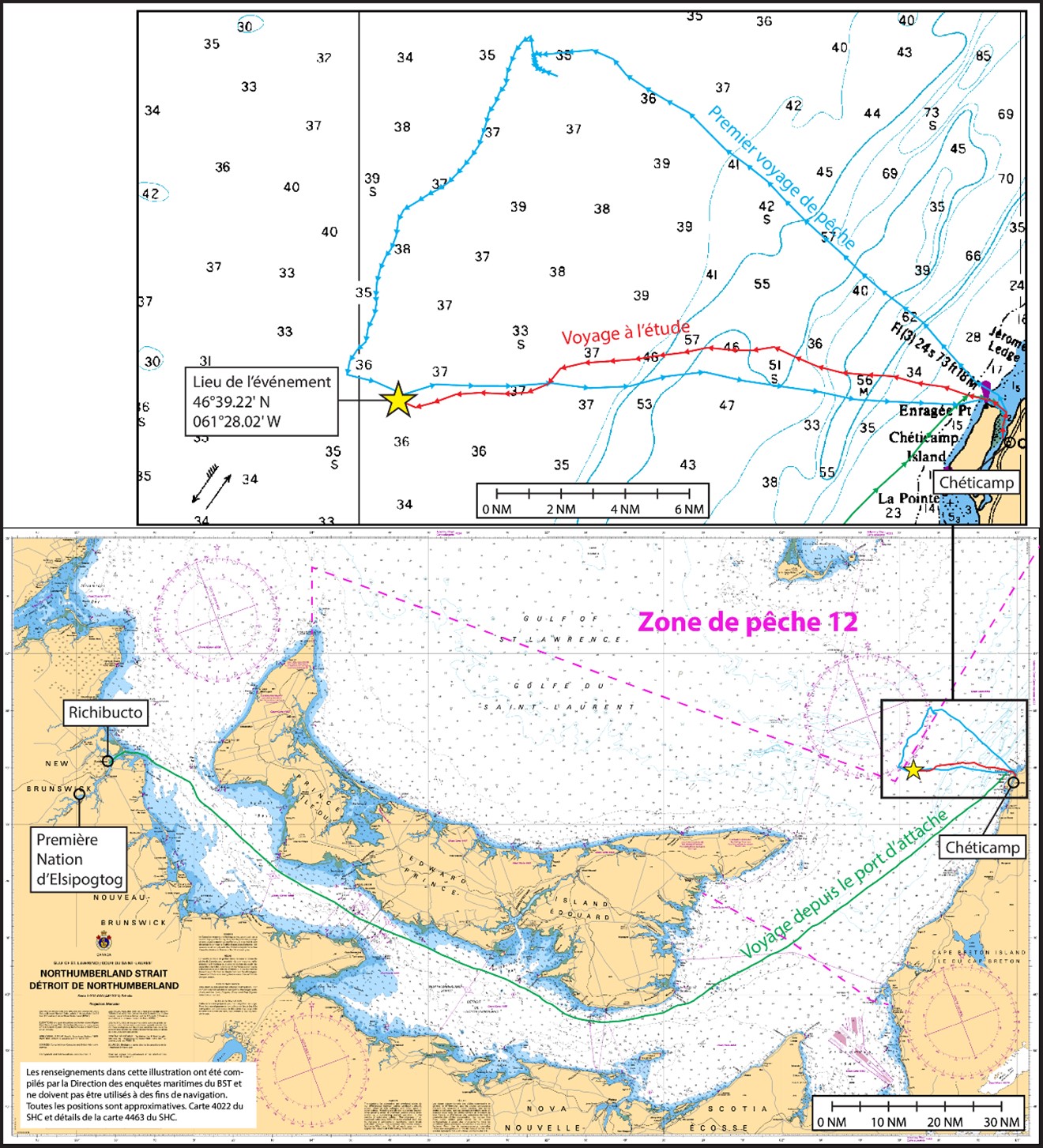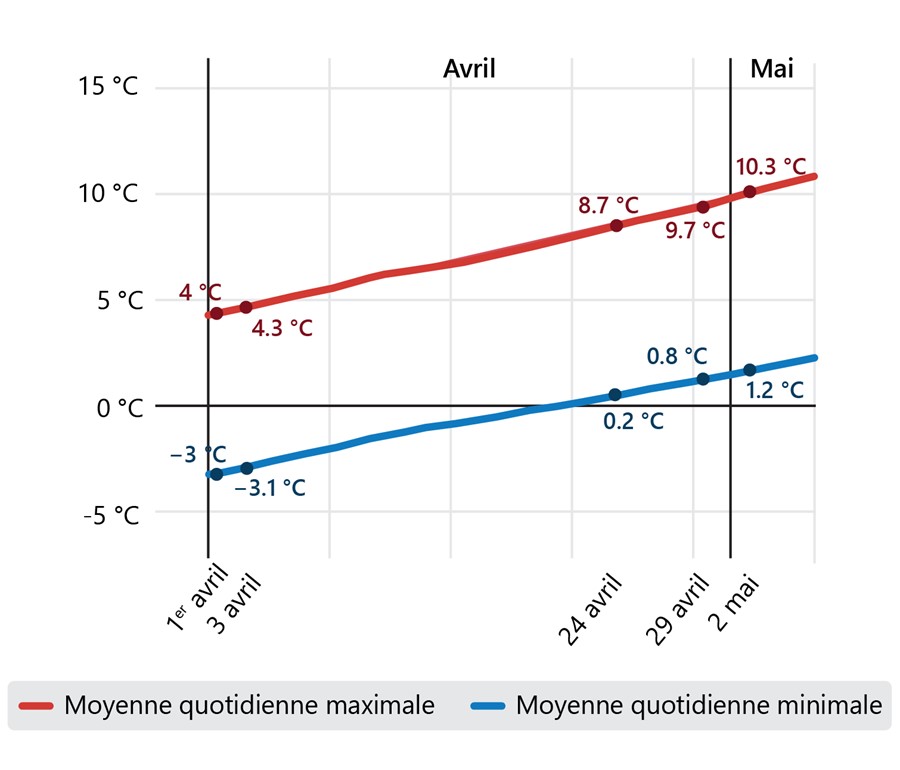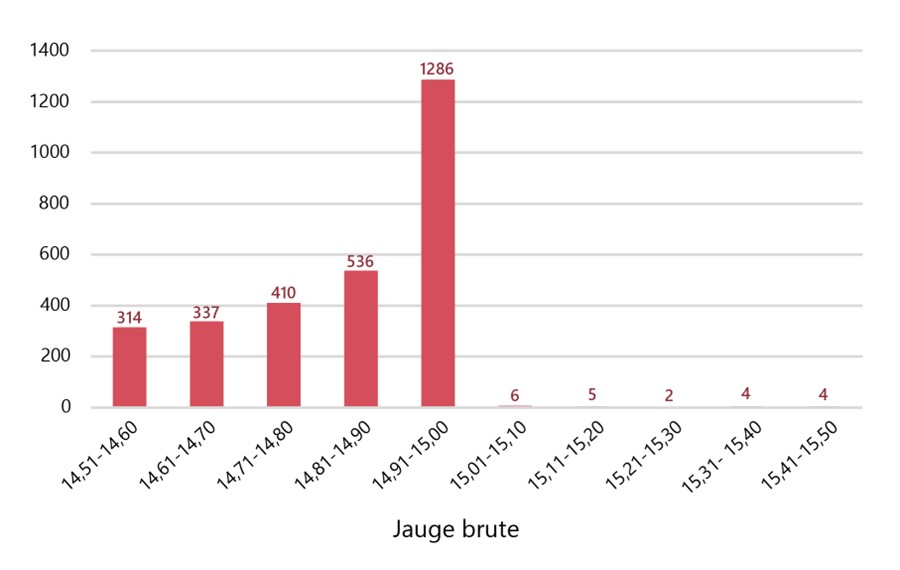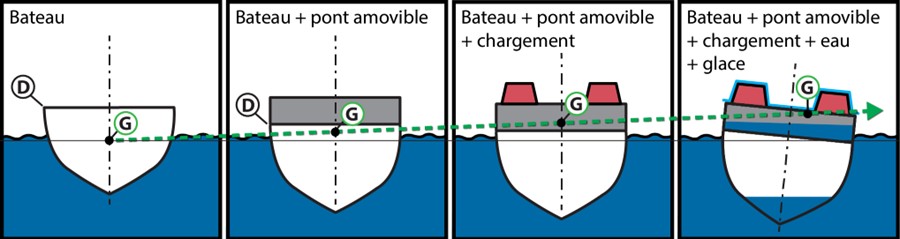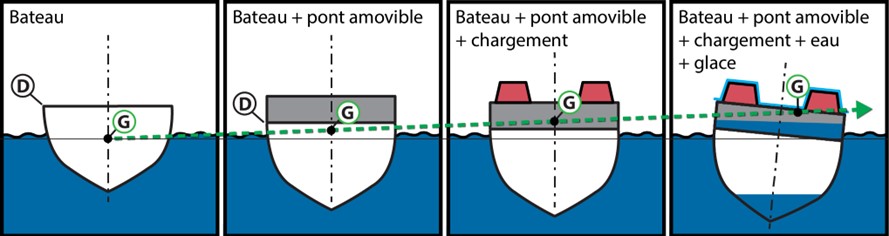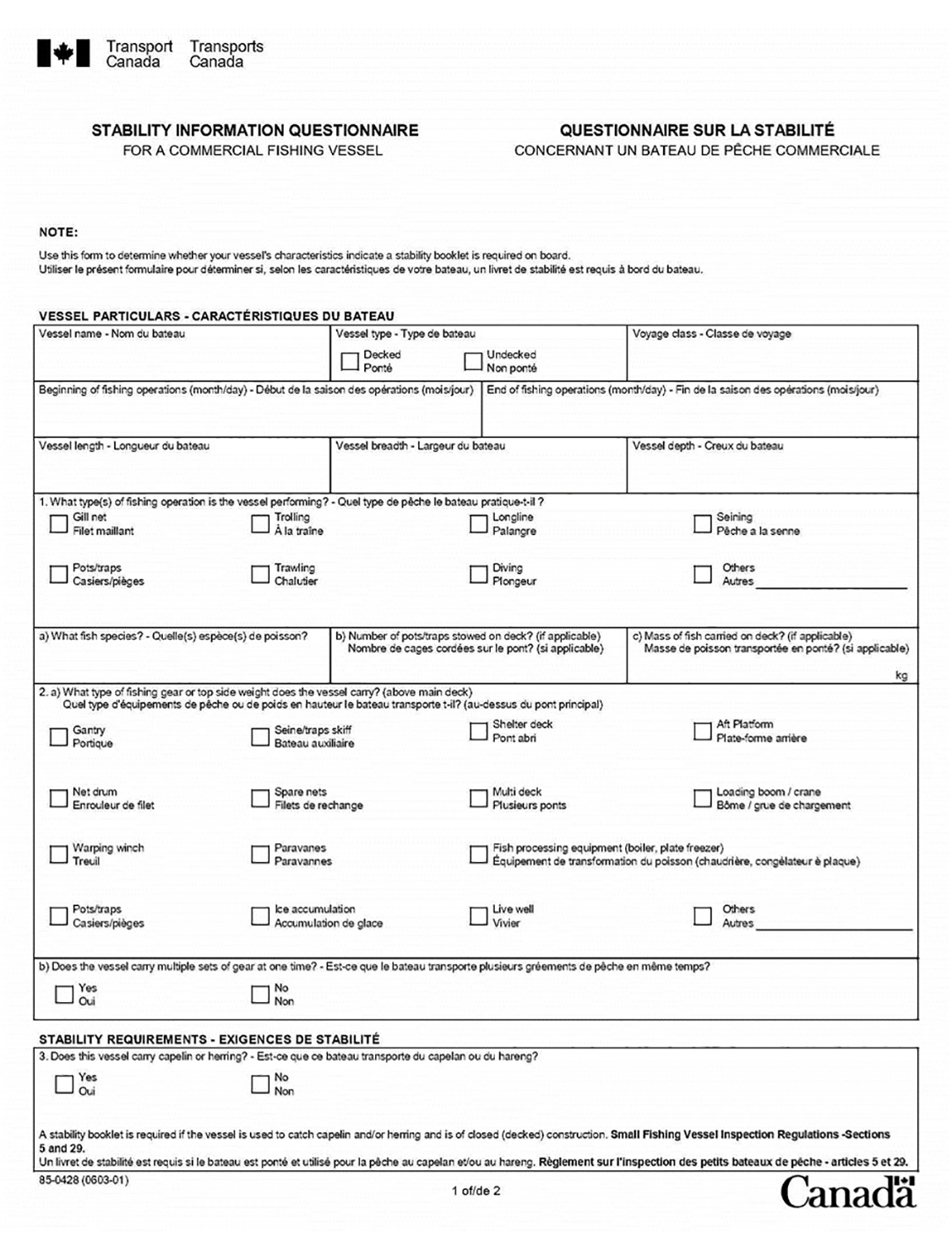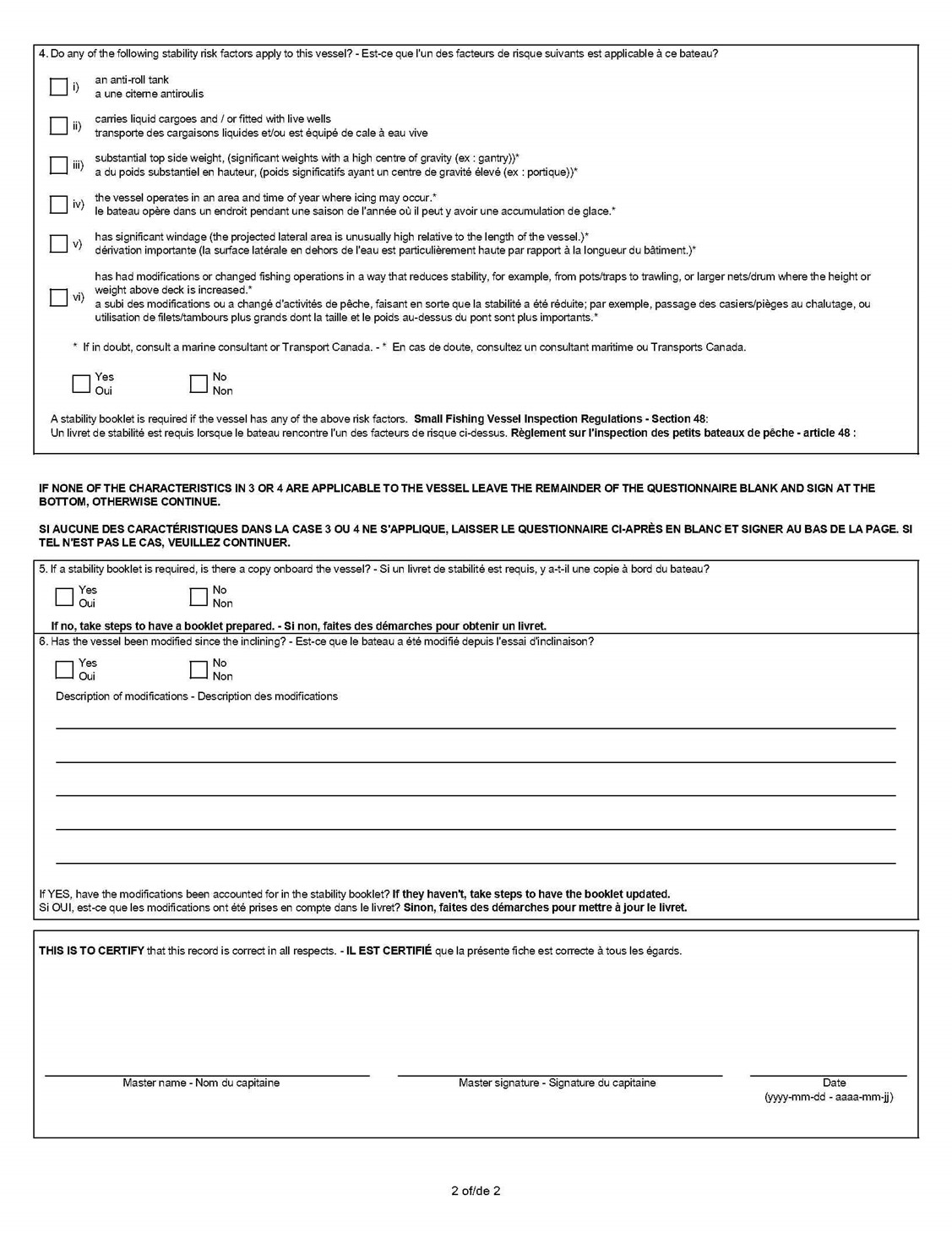Chavirement avec perte de vie
Bateau de pêche Tyhawk
Golfe du Saint-Laurent, 20 milles marins à l’ouest de Chéticamp (Nouvelle-Écosse)
Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).
Résumé
Le 1er avril 2021, Pêches et Océans Canada (MPO) a évalué les conditions météorologiques et a avisé les pêcheurs que la pêche au crabe des neiges dans la zone 12 du golfe du Saint-Laurent ouvrirait à 0 h 01 le 3 avril 2021. Au moment où l’avis a été émis, il y avait de la glace dans le port de Richibucto (Nouveau-Brunswick) et il a fallu utiliser une excavatrice pour briser la glace au quai afin de mettre le Tyhawk à l’eau.
Le 2 avril à 4 h 35, le capitaine et 4 membres d’équipage ont quitté Richibucto (Nouveau-Brunswick) pour se rendre à Chéticamp (Nouvelle-Écosse) à bord du Tyhawk, un bateau de pêche non ponté d’une longueur de 13,61 m, pour la saison. Ils ont été rejoints à Chéticamp par 4 autres membres d’équipage, venus de Richibucto en voiture.
Le 3 avril, à partir de 2 h 40 approximativement, le Tyhawk a effectué 2 voyages entre Chéticamp et les lieux de pêche. Lors du 1er voyage, effectué par le capitaine et les 8 membres d’équipage, ils ont posé environ 75 casiers à crabes. Au cours de ce voyage, une accumulation de glace s’est formée sur le bateau. Lors du 2e voyage, le capitaine et 4 membres d’équipage ont repris la mer pour poser une cinquantaine de casiers à crabes supplémentaires.
Pendant le voyage vers les lieux de pêche, le capitaine et 3 membres d’équipage ont fait une sieste dans les emménagements alors qu’un autre membre d’équipage assurait le quart. Les vents étaient passés de 20 à 25 nœuds avec des vagues de 1 à 2 m. Les vagues s’abattaient à tribord alors qu’il tombait de la pluie et de la pluie verglaçante. Un 2e membre d’équipage s’est présenté à la timonerie où il a remarqué une accumulation d’eau dans la cale. Il a appelé le capitaine et les autres membres d’équipage, puis les pompes de cale ont été mises en marche. Peu après, un membre d’équipage s’est rendu sous le pont amovible pour récupérer une partie des engins et a constaté la présence d’eau sur le pont principal. Il a alerté les autres membres d’équipage, puis on a changé la configuration de la pompe à grand débit pour assécher la cale. À ce moment-là, les conditions météorologiques ont semblé s’aggraver et les mouvements du bateau se sont intensifiés. À la suite d’une gîte importante sur tribord, le pont principal du bateau a été submergé, ce qui a eu pour effet de faire pénétrer de l’eau dans le Tyhawk, en plus de l’eau qui se trouvait déjà sur le pont.
Les membres d’équipage n’ont pas été en mesure d’atteindre les gilets de sauvetage et les combinaisons d’immersion rangés dans les emménagements ni de mettre à l’eau le radeau de sauvetage, qui avait glissé sous le pont amovible. Peu après, le Tyhawk a chaviré et le capitaine et les membres d’équipage sont montés sur la coque renversée. Un membre d’équipage a composé le 911. La radiobalise de localisation des sinistres (RLS) automatique s’est dégagée et, à 17 h 50, le Centre conjoint de coordination de sauvetage de Halifax a été avisé d’un signal RLS en provenance du Tyhawk.
Alors que le Tyhawk renversé s’enfonçait davantage dans l’eau, les vagues ont balayé à plusieurs reprises le capitaine et un membre d’équipage de la coque et les ont projetés dans l’eau. Le capitaine et ce membre d’équipage ont fini par rester dans l’eau. Le bateau de pêche Northumberland Spray est arrivé sur les lieux et a secouru les 4 membres d’équipage du Tyhawk, mais le capitaine n’a pas pu être retrouvé. Le Northumberland Spray est rentré à Chéticamp et les 4 membres d’équipage ont reçu des soins médicaux. La mort d’un membre d’équipage a été déclarée. Les recherches pour retrouver le capitaine se sont poursuivies toute la nuit ainsi que toute la journée du lendemain. À 19 h 55 le 4 avril 2021, l’affaire a été confiée à la GRC comme cas de personne disparue.
Modifications sans évaluation de la stabilité
Le Tyhawk avait été modifié par l’ajout d’un pont amovible. L’enquête a permis de déterminer que la stabilité du Tyhawk avait été compromise en partie par l’ajout du pont amovible, dont les effets sur la stabilité du bateau n’avaient pas été évalués. En 2013, Transports Canada (TC) a inspecté le bateau, a émis un avis de défaut en raison du pont amovible et a exigé une évaluation de la stabilité. Le capitaine a rempli un questionnaire sur la stabilité en mai 2015 et a indiqué la présence d’un pont amovible, mais n’a pas reconnu que ce dernier constituait une modification qui exigerait une évaluation de la stabilité. L’évaluation de la stabilité exigée par TC n’a pas été réalisée et les documents d’inspection ultérieurs de TC ne mentionnaient pas le pont amovible.
En ce qui concerne les petits bateaux de pêche et les autres petits bâtiments commerciaux (d’une jauge brute de 15 et moins) qui ne sont pas des navires à passagers, les définitions de « modification importante » (quelque chose qui « change considérablement » la capacité ou les dimensions d’un bâtiment de pêche) et les exigences relatives à une évaluation de la stabilité (quelque chose qui risque de compromettre la stabilité) sont qualitatives et sujettes à interprétation. Il incombe au représentant autorisé (RA) de déterminer si une modification est importante.
Bien que TC fournisse des lignes directrices pour aider les RA et les capitaines à cerner les modifications importantes, leur respect est de nature volontaire. De plus, les lignes directrices sont qualitatives et exigent une connaissance des principes de stabilité pour être interprétées correctement.
En l’absence d’une définition objective de « modification importante », il est possible que les effets d’une modification importante sur la stabilité d’un navire ne soient pas cernés par les RA, les capitaines et TC. Il existe donc un risque que les navires soient exploités sans disposer d’une stabilité suffisante pour les opérations auxquelles ils sont destinés. Par conséquent, le Bureau recommande que le ministère des Transports établisse des critères objectifs pour définir les modifications importantes apportées aux petits bateaux de pêche et autres petits bâtiments commerciaux (recommandation M23-06 du BST).
De plus, TC n’exige pas que les RA obtiennent une approbation préalable des modifications prévues ou qu’ils les fassent évaluer, ce qui pourrait également aider à déterminer si une modification risque de compromettre la stabilité. Une évaluation systématique menée par une personne compétente de l’ensemble des modifications prévues, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays, peut aider à déterminer celles qui constituent des modifications importantes et la nécessité d’entreprendre une évaluation de la stabilité. La surveillance réglementaire permet à TC d’évaluer les registres des modifications. Étant donné que les petits bateaux de pêche et les autres petits bâtiments commerciaux changent souvent de propriétaire, le fait d’avoir un registre établi des modifications peut aider à garantir que les RA, les capitaines et TC disposent de renseignements complets et à jour lorsqu’ils évaluent la stabilité des navires. Par conséquent, le Bureau recommande que le ministère des Transports exige que les modifications prévues aux petits bateaux de pêche et autres petits bâtiments commerciaux soient évaluées par une personne compétente, que tous les registres des modifications apportées à ces bateaux soient tenus à jour et que les registres soient mis à la disposition du ministère (recommandation M23-07 du BST).
Détermination des dangers dans le cadre de la gestion des ressources halieutiques
La perception du capitaine à l’égard du risque lié à l’opération de pêche prévue a été influencée par plusieurs pressions, notamment les incitatifs économiques et communautaires, les approbations et les certificats, ainsi que les expériences antérieures réussies. Par conséquent, le capitaine est parti en direction des lieux de pêche, en croyant probablement que le bateau était stable et bien adapté à la pêche au crabe des neiges.
Dans l’événement à l’étude, le MPO a devancé la date d’ouverture de la pêche au crabe des neiges de près de 3 semaines par rapport aux dates d’ouverture des années précédentes. Cette décision était fondée sur l’avis d’un sous-comité composé de représentants de l’industrie et du gouvernement. Le MPO et les membres du sous-comité ont traité le choix de la date et de l’heure d’ouverture de la pêche au crabe des neiges de 2021 comme un exercice de routine. Par conséquent, les dangers que présentait le changement de date, tels que la probabilité accrue d’eau plus froide, de glace et de pluie verglaçante, ou l’ouverture de la pêche à minuit, qui accroît le risque de fatigue, n’ont pas été cernés ou évalués afin de relever leurs répercussions sur la sécurité.
Les décisions complexes, comme celles relatives à la gestion des ressources halieutiques, doivent tenir compte de l’ensemble des domaines et des interactions pertinents et être appuyées par une évaluation complète et méthodique des risques. La qualité d’une évaluation des risques dépend de la rigueur avec laquelle les dangers sont recensés. Pour déterminer le plus grand nombre de dangers possible, tous les renseignements pertinents doivent être examinés par des experts dans leur domaine respectif, y compris des experts indépendants en matière de sécurité qui ne sont pas touchés par les décisions.
Lorsque les mesures et les décisions en matière de gestion des ressources halieutiques ne tiennent pas compte des interactions entre les facteurs économiques, de conservation et de sécurité, y compris leurs effets cumulatifs, il se peut que des décisions touchant des situations nouvelles et complexes soient prises sans que les dangers pour la sécurité aient été convenablement recensés, ce qui accroît les risques pour la sécurité des pêcheurs. Par conséquent, le Bureau recommande que le ministère des Pêches et des Océans veille à ce que les politiques, les procédures et les pratiques prévoient une détermination exhaustive des dangers et une évaluation des risques connexes pour les pêcheurs lorsque des décisions relatives à la gestion des ressources halieutiques sont prises et intègre une expertise indépendante en matière de sécurité à ces processus (recommandation M23-08 du BST).
1.0 Renseignements de base
1.1 Fiche technique du bateau
| Nom | Tyhawk |
|---|---|
| Numéro matricule auprès de Transports Canada | 836225 |
| Numéro d’immatriculation du bateau auprès de Pêches et Océans Canada | 159321 |
| Port d’immatriculation | Moncton (Nouveau-Brunswick) |
| Pavillon | Canada |
| Type | Bateau de pêche |
| Jauge brute | 15,23 |
| Longueur hors tout | 13,61 m |
| Construction | 2001, Guimond Boats Ltd., Escuminac (Nouveau-Brunswick) |
| Propulsion | Automoteur, à une seule hélice, de 366 kW |
| Équipage à bord | 5 |
| Propriétaire et représentant autorisé | Première Nation d’Elsipogtog (Nouveau-Brunswick) |
| MMSI (identité du service mobile maritime) | 316027189 |
1.2 Description du bateau
Le Tyhawk était un bateau de pêche construit en 2001 pour la pêche au homardNote de bas de page 1 (figure 1). Il s’agissait d’un bateau de style détroit de Northumberland, avec une coque moulée en plastique renforcé de fibre de verre et une petite cale à poisson. La timonerie était située à l’avant du milieu du bateau et était accessible par une porte coulissante depuis le pont arrière bâbord. Les emménagements étaient situés sous la timonerie et à l’avant de celle-ci et étaient accessibles par une ouverture se trouvant au centre de la timonerie ainsi que par une écoutille de secours sur le pont avant. Le compartiment moteur était situé à l’arrière des emménagements et était accessible par une petite écoutille dans le pont de la timonerie ou par une plus grande écoutille sur le pont principal. Le panneau d’écoutille du pont principal reposait sur une hiloire de 4 pouces et n’était pas étanche.
Le pont principal du Tyhawk se trouvait à 1,6 m au-dessus de la quille. Le pont principal comportait 3 écoutilles situées le long de l’axe longitudinal du bateau. Le bateau était non ponté et le pont principal n’était pas étanche. Il y avait 4 dalots d’environ 10 cm de diamètre chacun dans les pavois, 1 de chaque côté du pont arrière et 2 à la poupe. Les dalots permettaient d’évacuer l’eau par-dessus bord. Ils pouvaient être fermés par des bouchons filetés et étaient normalement maintenus fermés en mer.
Le Tyhawk était doté d’un pont amovible en aluminium servant lors de la pêche au crabe des neiges. Sur l’axe longitudinal, immédiatement derrière la timonerie et avant le pont amovible, se trouvaient un mât et une bôme utilisés pour récupérer les casiers à crabes.
La timonerie était équipée d’un système de surveillance des navires (SSN)Note de bas de page 2, d’un radar, d’un système de cartes électroniques, d’une radio à très haute fréquence avec système d’appel sélectif numérique (VHF-ASN)Note de bas de page 3, d’un GPS et d’un pilote automatique. On y trouvait également les interrupteurs des pompes de cale, une alarme de cale et 3 caméras de surveillance à distance dont les images étaient affichées sur un écran multifenêtres. Deux caméras surveillaient le pont arrière et une caméra surveillait le moteur dans le compartiment moteur. L’angle de la caméra située dans le compartiment moteur pouvait être modifié à distance pour surveiller le fond de cale.
Le Tyhawk était doté d’un radeau de sauvetage pneumatique pour 6 personnes. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS)Note de bas de page 4 à dégagement libre était installée sur le toit de la timonerie. Des gilets de sauvetage et des combinaisons d’immersion étaient rangés dans les emménagements. Le Tyhawk était également équipé d’un pistolet lance-fusées, de 2 extincteurs et d’une bouée de sauvetageNote de bas de page 5.
1.2.1 Pont amovible
En 2002, lorsque le Tyhawk a commencé à participer à la pêche au crabe des neiges, un pont amovible (figure 2) et une bôme ont été installés. Le pont amovible permettait d’entreposer les crabes des neiges vivants sur l’ensemble du pont arrière (pont principal), tout en laissant de l’espace pour ranger les casiers sur le pont amovible. Le pont amovible pesait environ 900 kg.
Le pont amovible était installé en une seule pièce au-dessus du pont principal et boulonné au sommet des pavois, ce qui laissait la zone entre le pont principal et le pont amovible dégagée. La liaison entre le haut des pavois et le pont amovible n’était pas étanche. La hauteur de la surface était d’environ 1,4 m au-dessus du pont principal (environ 0,45 m au-dessus du bord supérieur des pavois). Pour accéder à la partie supérieure du pont amovible, il fallait emprunter un escalier depuis la timonerie. On accédait à l’espace situé sous le pont amovible en passant par l’avant (près de la porte de la timonerie) ou par l’une des 3 écoutilles situées sur le dessus du pont amovible. Lorsque le pont amovible était en place, le compartiment moteur demeurait accessible par l’écoutille du pont principal. Les pavois du pont amovible comportaient des sabords de décharge de part et d’autre.
1.2.2 Pompes du bateau
Le bateau était équipé des pompes suivantes :
- une pompe de cale automatique de 12 V dotée d’un interrupteur à flotteur et pouvant évacuer 3700 gallons d’eau par heure, située à l’avant du compartiment moteur;
- une pompe de cale manuelle de 12 V dotée d’un interrupteur à flotteur et pouvant évacuer 2000 gallons d’eau par heure, située à l’arrière du compartiment moteur;
- une pompe portative de rechange de 12 V (rangée);
- une pompe à grand débit entraînée par moteurNote de bas de page 6.
Un capteur de haut niveau d’eau de cale se trouvait à l’avant dans le compartiment moteur (figure 3).
Les pompes installées sur le Tyhawk satisfaisaient aux exigences relatives aux pompes de cale en vertu du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (RSBP)Note de bas de page 7.
1.3 Déroulement du voyage
Les bateaux de pêche d’Elsipogtog sont entreposés à terre pendant la saison hivernale. Les capitaines et les membres d’équipage sont chargés de déshivériser les bateaux et de les préparer pour la saison de pêche. Dans le cas du Tyhawk, les préparatifs consistaient notamment à mettre le bateau à l’eau, à installer le pont amovible et les engins de sauvetage, à s’assurer que le bateau contenait du carburant et de l’eau et que tout l’équipement mécanique et électrique fonctionnait, à vérifier, réparer et charger les engins de pêche nécessaires, tels que les casiersNote de bas de page 8, les lignes de fond et les mâts porte-drapeau, ainsi qu’à acheter et à charger les appâts et les provisions. Le nouveau radeau de sauvetage pour 6 personnes du Tyhawk était entreposé non arrimé à l’arrière de la timonerie.
En 2021, lorsque la date du début de la saison a été annoncée, il y avait de la glace dans le port de Richibucto (Nouveau-Brunswick) et il a fallu utiliser une excavatrice pour briser la glace au quai afin de mettre le Tyhawk à l’eau.
Le 1er avril 2021, Pêches et Océans Canada (MPO) a évalué les conditions météorologiques et a émis un avis aux pêcheursNote de bas de page 9 pour indiquer que la pêche au crabe des neiges dans la zone 12 du golfe du Saint-Laurent ouvrirait à 0 h 01Note de bas de page 10 le 3 avril 2021.
Le 2 avril à 4 h 35, le capitaine et 4 membres d’équipage ont quitté Richibucto (Nouveau-Brunswick) pour se rendre à Chéticamp (Nouvelle-Écosse) à bord du Tyhawk pour la saison (figure 4), ce qui représentait un voyage d’environ 16 heures. Ils ont été rejoints à Chéticamp par 4 autres membres d’équipage, venus de Richibucto en voiture, soit un trajet d’environ 6 heures. Vers 20 h 30, le Tyhawk est arrivé à Chéticamp et tous les membres d’équipage ont commencé à charger le bateau.
Le 3 avril vers 2 h 40, le Tyhawk a quitté Chéticamp, avec le capitaine et les 8 membres d’équipage à son bord, ainsi qu’environ 75 casiers à crabes entreposés non arrimés sur le pont amovible. Le voyage de 20 milles marins (NM) jusqu’aux lieux de pêche a duré environ 2 heures. Au cours du voyage, une accumulation de glace s’est formée sur le bateau. Le capitaine et les membres de l’équipage ont posé les casiers à crabes et ont regagné Chéticamp, où ils sont arrivés vers 11 h 10. Lors de ce voyage, le Tyhawk a rencontré des vents d’environ 15 nœuds et des vagues d’une hauteur d’environ 1 m accompagnées de pluie et de pluie verglaçante.
À leur arrivée à Chéticamp, les 4 membres d’équipage qui s’étaient rendus à Chéticamp à bord du Tyhawk ont quitté le bateau pour aller se reposer et se réchauffer. Les 4 autres membres d’équipage (membres d’équipage 1 à 4) ont chargé environ 50 casiers à crabes. Les casiers ont été rangés de la même façon que ceux du voyage précédent, c’est-à-dire sans être arrimés sur le pont amovible, et l’équipement connexe (cordes dans des caisses, environ 225 kg d’appâts et bouées) ont été rangés entre le pont amovible et le pont principal.
Vers 15 h 20, le Tyhawk a quitté de nouveau Chéticamp avec le capitaine et les membres d’équipage 1 à 4 à son bord pour poser les casiers à crabes près de la 1re série de casiers. Une fois le bateau sorti du port, les membres d’équipage 2, 3 et 4 sont descendus pour faire une sieste. Après un certain temps, le capitaine a été relevé du quart à la barre par le membre d’équipage 1. Le capitaine et les 3 autres membres d’équipage sont demeurés dans les emménagements pour faire une sieste.
Pendant le voyage, les vents étaient passés de 20 à 25 nœuds avec des vagues de 1 à 2 m. Les vagues s’abattaient à tribord alors qu’il tombait de la pluie et de la pluie verglaçante. Au bout d’un certain temps, le membre d’équipage 2 s’est présenté à la timonerie et le membre d’équipage 1 lui a demandé de prendre la barre.
Lorsque le membre d’équipage 2 a pris la barre, il a ajusté l’angle de la caméra dans le compartiment moteur et a remarqué une accumulation d’eau dans la cale. Vers 17 h 35, les membres d’équipage 1 et 2 ont appelé le capitaine, qui s’est rendu à la timonerie, a pris la barre et a mis en marche manuellement les 2 pompes de cale. Les autres membres d’équipage ont également été réveillés à ce moment-là et le capitaine leur a demandé de se préparer à poser les casiers.
Vers 17 h 40Note de bas de page 11, le membre d’équipage 2 s’est rendu sous le pont amovible pour récupérer une partie des engins de pêche. Il a constaté la présence d’eau sur le pont principal et a alerté les autres membres d’équipage. L’eau s’était accumulée principalement vers la poupeNote de bas de page 12. Le membre d’équipage 4 a réagi en ouvrant l’écoutille dans la timonerie pour accéder au compartiment moteur et a changé la configuration de la pompe à grand débit pour assécher la cale. Le membre d’équipage 2 a regardé par-dessus bord pour voir s’il y avait des signes d’assèchement, mais il n’a vu qu’un peu d’eau s’écouler. À ce moment-là, les conditions météorologiques ont semblé s’aggraver et les mouvements du bateau se sont intensifiés.
Environ 1 minute plus tard, le bateau a gîté sur tribord, ce qui a eu pour effet de faire glisser de ce côté l’eau et les engins supplémentaires se trouvant sur le pont principal, ainsi que les casiers sur le pont amovible. Le membre d’équipage 3, qui venait d’arriver sur le pont depuis les emménagements, s’est retrouvé temporairement coincé entre les piles de casiers alors que le bateau gîtait sur tribord. Le membre d’équipage 3 a reçu de l’aide des autres membres d’équipage pour s’extraire de la pile de casiers et est demeuré sur le pont. Le capitaine a utilisé son téléphone pour envoyer un message texte de détresse au capitaine du Northumberland Spray, qui pêchait à environ 6 NM de là. Le capitaine du Tyhawk a également appuyé sur le bouton de détresse de la radio VHF-ASN, mais aucun signal de détresse n’a été reçu par une station VHF-ASN se trouvant à proximitéNote de bas de page 13. La gîte sur tribord du bateau a été suffisante pour submerger le bord du pont principal et permettre la pénétration d’une plus grande quantité d’eau dans le Tyhawk.
Le membre d’équipage 1, qui se trouvait toujours dans la timonerie, a tenté d’atteindre les gilets de sauvetage et les combinaisons d’immersion rangés dans les emménagements, mais n’y est pas parvenu en raison de la détérioration de la situation. Pendant ce temps, le membre d’équipage 2 a tenté de mettre à l’eau le radeau de sauvetage, qui n’était pas arrimé sur le pont principal, mais le radeau a glissé sous le pont amovible. Le membre d’équipage 4 est sorti du compartiment moteur par la timonerie et est demeuré sur le pont amovible.
Vers 17 h 42, la gîte sur tribord a augmenté au point où le bateau a chaviré à 46°39.22′ N, 061°28.02′ W (figure 4). Le membre d’équipage 3 s’est hissé par-dessus bord sur la coque renversée. Il a ensuite composé le 911. Les membres d’équipage 2 et 4 sont tombés à l’eau lorsque le bateau a chaviré, puis sont montés sur la coque. Le capitaine a aidé le membre d’équipage 1 à sortir par la fenêtre de la timonerie avant de le faire lui-même à son tour et tous deux sont entrés dans l’eau avant de monter sur la coque renversée.
À 17 h 46, l’appel 911 a été signalé au Centre conjoint de coordination de sauvetage de Halifax, qui a lancé un appel Mayday par l’intermédiaire des Services de communications et de trafic maritimes de Sydney à 17 h 49 et a commencé à affecter des ressources. La RLS automatique, qui était correctement enregistrée, s’est dégagée et a fonctionné comme prévu environ 3 minutes après le chavirement. À 17 h 50, le Centre conjoint de coordination de sauvetage de Halifax a été avisé d’un signal de la RLS en provenance du Tyhawk.
Alors que le Tyhawk renversé s’enfonçait davantage dans l’eau, les vagues ont balayé à plusieurs reprises le capitaine et le membre d’équipage 4 de la coque et les ont projetés dans l’eau. Les autres membres d’équipage les ont ramenés sur la coque plusieurs fois, mais le membre d’équipage 4 et le capitaine ont fini par rester dans l’eau.
À 18 h 34, le bateau de pêche Northumberland Spray est arrivé sur les lieux et a secouru les membres d’équipage 1, 2, 3 et 4 du Tyhawk, mais le capitaine n’a pas pu être retrouvé. Le Northumberland Spray est rentré à Chéticamp et les 4 membres d’équipage ont reçu des soins médicaux. La mort du membre d’équipage 4 a été déclarée.
Les recherches pour retrouver le capitaine se sont poursuivies toute la nuit ainsi que toute la journée du lendemain. À 19 h 55 le 4 avril 2021, l’affaire a été confiée à la GRC comme cas de personne disparue.
1.4 Conditions environnementales
Les prévisions météorologiques émises par Environnement et Changement climatique Canada pour le secteur Golfe-Madeleine-moitié est pour 10 h le samedi 3 avril 2021 étaient les suivantes : des vents soufflant du nord-est à 15 nœuds, augmentant à 20 nœuds en fin d’après-midi samedi, puis virant à des vents soufflant de l’est à 25 nœuds dimanche matin; des périodes de pluie verglaçante se changeant en neige vers minuit; une visibilité de 1 mille ou moins. La température de l’air était de 1 °C et celle de l’eau de −0,6 °C.
Les températures moyennes au début du mois d’avril sont généralement inférieures ou proches du point de congélation, comparativement aux températures à la fin du mois d’avril, soit les dates habituelles d’ouverture de la saison, quand la température moyenne minimale est supérieure au point de congélation (figure 5). Il y a eu 12 heures et 57 minutes de lumière du jour le 3 avril 2021.
1.5 Certificats du bateau
Le Tyhawk avait un certificat d’inspection à jour pour les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15 et de moins de 150 pour les voyages à proximité du littoral, classe IINote de bas de page 14. Le bateau avait également un document à jour sur l’effectif minimal de sécurité.
Le document sur l’effectif minimal de sécurité émis en 2017 pour le Tyhawk indiquait qu’il s’agissait d’un bâtiment de jourNote de bas de page 15. Selon les exigences de quart applicables aux bâtiments de jour, le capitaine doit être titulaire d’un brevet de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe ou d’un brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche d’une jauge brute de 60 et un autre membre d’équipage doit être titulaire d’un certificat valide de formation sur les fonctions d’urgence en mer (FUM) — Sécurité de base. Une autre personne de quart certifiée était requise si le bateau était exploité pendant la nuit sans séjour au port.
1.6 Brevets, certificats et expérience des membres d’équipage
Le capitaine était titulaire d’un brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche d’une jauge brute de 60, délivré en 2008Note de bas de page 16. Il avait suivi la formation FUM — Sécurité de base en 2001 et celle relative au certificat d’opérateur radio — maritime commercial en 2005. Le capitaine comptait plus de 20 années d’expérience de la pêche.
Le membre d’équipage 1 avait déjà effectué 2 voyages de pêche.
Le membre d’équipage 2 avait suivi la formation sur les compétences des conducteurs de petits bâtiments ainsi que celles relatives à l’utilisation des cartes, à la sécurité de la navigation et aux FUM — Sécurité de base (2016). Le membre d’équipage 2 possédait 8 ans d’expérience de la pêche et était affecté au navire Lady Margaret I d’Elsipogtog à titre de capitaine.
Le membre d’équipage 3 effectuait son 1er voyage de pêche.
Le membre d’équipage 4 comptait plus de 3 années d’expérience de la pêche.
Les membres d’équipage 1 à 4 étaient affectés à l’origine au Lady Margaret I et ne connaissaient pas bien le Tyhawk.
1.7 Inspection d’assurance du bateau
La fonction principale d’une inspection d’assurance est de déterminer l’état d’un navire ainsi que ses valeurs de marché et de remplacement actuelles.
Le Tyhawk a fait l’objet d’une inspection d’assurance en décembre 2020. Les commentaires indiquaient que le bateau était en bon état et ne présentait aucun signe d’usure excessive ou de délaminage de la fibre de verre.
1.8 Activités d’Elsipogtog
Au moment de l’événement, la Première Nation d’Elsipogtog comptait 62 bateaux immatriculés auprès de Transports Canada (TC) et était le représentant autorisé (RA) de tous ces navires. Parmi les bateaux immatriculés, il y en avait 12 qui devaient être inspectés et certifiés par TC. La Première Nation d’Elsipogtog était titulaire de permis délivrés par le MPO l’autorisant à pêcher 20 espèces. Tous les bateaux d’Elsipogtog utilisés pour la pêche au crabe des neiges mesuraient moins de 45 piedsNote de bas de page 17. Dans le sud du golfe du Saint-Laurent, bon nombre des bateaux utilisés pour la pêche au crabe des neiges sont plus longs.
En ce qui concerne la flotte d’Elsipogtog, une grande partie des responsabilités du RA étaient assumées par la personne responsable des pêches d’Elsipogtog. Cette personne gérait les exigences de TC et les permis de pêche du MPO. De plus, elle était présente lors de la réunion sur l’ouverture de la saison avec le MPO et d’autres pêcheurs.
Environ 360 personnes prennent part aux activités de pêche d’Elsipogtog, soit en tant que pêcheurs, soit en tant qu’employés de l’usine de traitement du poisson appartenant à la communauté.
1.9 Surveillance et responsabilités de Transports Canada
TC est l’organisme de réglementation fédéral chargé de la sécurité des équipages et des navires. TC possède une expertise en matière de stabilité des navires et d’intégrité de la coque et est souvent appelé à mettre cette expertise au service de groupes consultatifs. TC est également chargé des activités de sensibilisation, ce qui comprend la promotion de la sûreté et de la sécurité et la collaboration avec d’autres organisations qui exercent une influence sur la sécurité des équipages et des navires.
Une partie de la surveillance de la sécurité des équipages et des navires effectuée par TC consiste à s’assurer que les RA procèdent à l’immatriculation de leurs navires et qu’ils les font inspecter lorsque ces derniers nécessitent une certification. Avant 2007, seuls les navires d’une jauge brute de plus de 15 devaient être immatriculés. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) en 2007, les navires d’une jauge brute de 15 ou moins doivent également être immatriculés auprès de TC. Cette obligation d’immatriculation élargie a touché des milliers de bateaux de pêche commerciale. Dans le cadre du processus d’immatriculation, TC exige un jaugeage.
Le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtimentNote de bas de page 18 exige que tous les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15 qui sont utilisés à des fins commerciales détiennent un certificat d’inspection valide, attestant de leur conformité avec les règlements pertinents, avant d’entreprendre des activités. TC effectue l’inspection requise aux fins de certification à la demande d’un RA.
Pour les bateaux de pêche d’une jauge brute de plus de 15, tels que le Tyhawk, des inspections sont requises tous les 4 ans. Une fois qu’une inspection aux fins de certification a été demandée, un inspecteur de la sécurité maritime visite le bateau, inspecte la coque, les machines et les engins de sauvetage et examine la documentation, tels que les documents maritimes canadiens, les procédures écrites et les dossiers d’entretienNote de bas de page 19. Les inspecteurs de TC consignent les lacunes et les résultats des inspections dans le Système de rapports d’inspection des navires. Le processus d’inspection comprend une étape visant à vérifier que les lacunes antérieures ont été corrigéesNote de bas de page 20. Les inspecteurs peuvent consulter les renseignements relatifs aux inspections précédentes dans le Système de rapports d’inspection des navires.
Si des lacunes sont constatées lors d’une inspection, le RA en est informé. Selon le degré de gravité attribué à la lacune par l’inspecteur, le RA peut être tenu de corriger celle-ci avant que le navire appareille ou il peut se voir accorder un délai pour y remédier. Il est possible de présenter au Bureau d’examen technique en matière maritime une proposition visant à corriger une lacune qui aurait été relevée, en vue d’obtenir des exemptions ou des équivalences liées aux exigences réglementaires. Les inspecteurs peuvent également modifier à tout moment les mesures correctives requises en cas d’évolution du degré de gravité. Selon les lacunes et la nécessité d’un suivi, les inspecteurs peuvent délivrer un certificat à court terme, choisir de ne pas délivrer de certificat ou ordonner la détention d’un navire s’il possède déjà un certificat d’inspection. D’après les renseignements reçus de TC, 1093 certificats ont été délivrés à des navires de pêche canadiens d’une jauge brute de plus de 15 jusqu’à 150 au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022. De ce nombre, 244 étaient des certificats à court terme. Au cours de la même période, 424 navires de cette jauge brute ont dû corriger une lacune avant de pouvoir appareiller et 6 navires ont fait l’objet d’une ordonnance de détention.
Outre les inspections aux fins de certification, TC mène occasionnellement des campagnes d’inspection concentrées (CIC). Les CIC sont une série d’inspections qui portent sur des domaines précis de préoccupation en matière de sécurité sur des navires sélectionnés. Les CIC ciblent les éléments pour lesquels les inspecteurs de la sécurité maritime ont constaté un grand nombre de lacunes ou pour lesquels de nouvelles exigences réglementaires sont récemment entrées en vigueur. La CIC de 2021-2022 de TC était axée sur la conformité au RSBP. Un résumé des conclusions a été présenté lors de la réunion du Conseil consultatif maritime canadien tenue au printemps 2022Note de bas de page 21. La campagne a permis d’inspecter 101 navires de pêche, dont 83 % étaient des navires d’une jauge brute de plus de 15 et ainsi sujets à inspection. La campagne a révélé que 62 % des 101 navires avaient des lacunes de sécurité. La campagne a également permis de constater ce qui suit :
- le plus grand nombre de lacunes était lié à l’absence de procédures, de dossiers et d’exercices;
- 17 % des répondants ont déclaré avoir apporté une modification importante à leur navire, dont 41 % n’avaient pas assuré le suivi de ces modifications ou n’en avaient pas informé TC;
- 30 % des équipages de navires de pêche n’étaient pas en mesure de démontrer leur connaissance des procédures;
- 79 % des navires ne détenaient pas de certificats à jour;
- 80 % des navires avaient des avis de défaut non réglés provenant d’inspections précédentes.
TC peut également effectuer des inspections fondées sur les risques sur un navire, peu importe sa tailleNote de bas de page 22. Par exemple, après cet événement, TC a reçu une plainte et a procédé à l’inspection de 7 navires utilisant des ponts amovibles et pratiquant la pêche au crabe dans la région de Chéticamp. Les 7 navires ont reçu des avis de défaut et ont tous été tenus de faire l’objet d’une évaluation de la stabilité ou de désinstaller leur pont amovible avant l’appareillage.
Lorsqu’une violation des règlements sur la sécurité est relevée par l’intermédiaire de rapports d’accident, d’enquêtes réglementaires ou d’inspections de navires, TC peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’encontre des RA ou des capitaines : émettre des avertissements écrits ou verbaux ou des avis de violation ou imposer des sanctions administratives pécuniaires.
À la suite de l’événement, TC a émis un avis de violation et a imposé une sanction administrative pécuniaire à la Première Nation d’Elsipogtog. La sanction portait sur le fait d’avoir omis de s’assurer que le Tyhawk, ses machines et son équipement répondaient aux exigences du RSBP et d’avoir omis d’élaborer des procédures écrites pour l’exploitation sécuritaire du bateau et en cas d’urgenceNote de bas de page 23.
1.9.1 Modifications importantes
Une modification importante « s’entend d’une modification ou d’une réparation, ou d’une série de modifications ou de réparations, qui change considérablement la capacité ou les dimensions d’un bâtiment de pêche ou la nature d’un système à bord de celui-ci, ou qui a une incidence sur l’étanchéité à l’eau ou la stabilité de celui-ciNote de bas de page 24 ». Les termes « considérablement » et « incidence » sont qualitatifs et sujets à différentes interprétations. Cette définition a été incluse dans le RSBP dans le cadre des modifications apportées au Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche (RIPBP). Dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié en 2016 relatif à ces modifications, on a estimé que 25 % des navires de pêche feraient l’objet de modifications importantesNote de bas de page 25. Quelques années plus tard, Fish Safe NS a estimé que la majorité des navires de pêche en Nouvelle-Écosse ont fait l’objet de modifications non déclaréesNote de bas de page 26. En outre, la définition de « modification importante » est également utilisée pour les petits bâtiments commerciaux autres que les bateaux de pêcheNote de bas de page 27.
TC n’exige pas que les RA obtiennent une approbation préalable des modifications prévues ou qu’ils les fassent évaluer. Dans d’autres pays, les propriétaires de bateaux de pêche sont tenus de demander une approbation avant de procéder à des modificationsNote de bas de page 28,Note de bas de page 29. Plusieurs enquêtes du BSTNote de bas de page 30 ont permis de repérer des navires sur lesquels des modifications importantes avaient été apportées, sans qu’elles soient signalées.
1.9.2 Jauge brute d’un navire
La jauge brute est une mesure du volume de tous les espaces clos à bord d’un navire. La jauge brute est utilisée pour déterminer les normes de sécurité selon lesquelles le navire est construit et les certificats d’inspection requis. La jauge brute est également importante pour les pêcheurs, car elle permet d’évaluer sa capacité, ce qui est important pour l’entreposage des engins de pêche et des captures.
Lors de la conception d’un navire, on estime sa jauge brute. Si la jauge brute est estimée à plus de 15, TC examine les plans de construction afin de confirmer que le navire sera sûr et adapté aux voyages auxquels il est destiné. Si la jauge brute est estimée à 15 ou moins, TC n’examine pas les plans de construction. Avant 2017, le RIPBP s’appliquait et comprenait une norme de sécurité détaillée pour la construction de navires d’une jauge brute de plus de 15. Après 2017, le RSBP s’applique et comprend la même norme de sécurité. Par exemple, ce règlement comprend des spécifications relatives à des éléments tels que la disposition des pompes de cale mécaniques, les installations immergées, les diamètres des arbres moteurs, les ponts, les écoutilles et les cloisons étanches, les sabords de décharge, la ventilation et l’éclairage de secours. Le RIPBP ne prévoyait pas de norme de sécurité particulière relative à ces éléments pour les navires d’une jauge brute de 15 ou moins et, par conséquent, le RSBP n’en prévoit pas non plus.
Après la construction d’un navire et avant qu’il puisse être immatriculé auprès de TC, la jauge brute doit être mesurée ou attribuée afin de remplacer celle estimée à l’étape de la planification. La jauge brute peut être mesurée conformément à la Convention internationale sur le jaugeage ou en utilisant une méthode simplifiée basée sur les mesures de longueur, de largeur et de profondeurNote de bas de page 31. TC ne vérifie pas les mesures consignées au registre. Bon nombre de bateaux de pêche sont immatriculés avec une jauge brute légèrement inférieure à 15 (figure 6). Le BST a constaté que de nombreux propriétaires de bateaux de pêche ne sont pas au courant de l’obligation de faire immatriculer les navires de cette taille et qu’il y a un grand nombre de bateaux de pêche non immatriculés dont la jauge brute exacte est inconnue. Certains de ces bateaux non immatriculés sont en cours d’immatriculation grâce aux efforts continus déployés par le MPO et TC en réponse à la recommandation M22-01 du BST. Au fur et à mesure que ces bateaux de pêche sont immatriculés, ceux-ci sont mesurés et certains d’entre eux s’avèrent avoir une jauge brute de 15 ou plus.
1.9.3 Chronologie de la certification du bateau
Le Tyhawk a été mis en service en 2001. Étant donné que l’estimation initiale de la jauge brute était inférieure à 15, aucun certificat d’inspection n’était requis pour ce bateau et, par conséquent, ce dernier n’a pas été inspecté par TCNote de bas de page 32.
En 2006, la Première Nation d’Elsipogtog a procédé à l’immatriculation du Tyhawk et a indiqué une jauge brute de 14,75. En 2011, dans le cadre du processus d’immatriculation, le Tyhawk a été mesuré par un jaugeur certifié et il s’est avéré qu’il avait une jauge brute de 15,23. Cette jauge brute a été inscrite dans le registre de TC. Par conséquent, en 2012, le Tyhawk est devenu assujetti à la surveillance de TC concernant les navires d’une jauge brute de plus de 15, ce qui inclut des inspections aux fins de certification.
En avril 2013, TC a inspecté le Tyhawk. Le pont amovible était en place au moment de l’inspection. La durée de validité d’un certificat résultant d’une inspection n’ayant permis de relever aucune lacune est de 48 mois. Dans ce cas, le certificat a été délivré pour une période de 6 mois, soit jusqu’en octobre 2013. Le certificat d’inspection était accompagné d’un long avis de défaut notant des non-conformités réglementaires. L’avis faisait état d’un arbre moteur trop petit, ainsi que de l’obligation d’ajouter une écoutille de secours et d’effectuer une évaluation de la stabilité en raison de la modification apportée au bateau par l’ajout du pont amovible. Le RA ou le capitaine devait remplir un questionnaire sur la stabilité. Ces lacunes devaient être corrigées pour que le Tyhawk puisse satisfaire à la norme de sécurité applicable aux navires d’une jauge brute de plus de 15.
En mai 2014, TC a effectué une inspection de suivi du Tyhawk. Le questionnaire sur la stabilité qui devait être rempli l’année précédente ne l’avait pas été. L’inspecteur a délivré un autre certificat d’inspection à court terme pour une période de 6 mois, soit jusqu’en octobre 2014.
En mai 2015, TC a procédé à une autre inspection de suivi. Au cours de cette inspection, le capitaine a rempli et présenté le questionnaire sur la stabilité (voir l’annexe A pour consulter le questionnaire). Le capitaine a indiqué la présence à bord du pont amovible, mais il ne l’a pas désigné comme un facteur de risque pour la stabilité qui ajoutait un poids considérable à la partie supérieure du bateauNote de bas de page 33. Le capitaine a également inscrit que des casiers et une bôme/grue de chargement se trouvaient à bord. Un certificat d’inspection a été délivré pour le reste de la période, qui a expiré en avril 2017.
En avril 2017, TC a de nouveau inspecté le Tyhawk. Un certificat d’inspection couvrant toute la période de validité (4 ans) a été délivré et aucune lacune n’a été relevée. Les dossiers montrent qu’une partie, mais non la totalité, des éléments figurant sur l’avis de défaut original de juin 2013 avaient été traités. Le pont amovible n’était pas en place au moment de l’inspection, et TC a estimé que les lacunes relatives au pont amovible relevées en 2013 n’existaient plus.
Aucune exemption ou équivalence n’avait été accordée au Tyhawk par le Bureau d’examen technique en matière maritime.
1.10 Stabilité
La stabilité fait référence à la capacité d’un navire à se redresser lorsqu’il est perturbé par une force extérieure comme le vent, les vagues ou les activités de pêche. La stabilité d’un navire peut être compromise par de nombreux facteurs tels que son étanchéité à l’eau, les effets d’ajouts ou de modifications, la quantité et l’emplacement des engins et des captures à bord, l’accumulation de glace, son franc-bord et les espaces où l’eau peut s’accumuler (figure 7). Tous les bateaux de pêche doivent avoir une stabilité suffisante pour mener à bien les activités de pêche en toute sécuritéNote de bas de page 34.
Parmi les caractéristiques des navires qui influent sur la stabilité figurent les suivantes :
- Le centre de gravité : L’emplacement du centre de gravité dépend de la forme du navire, du poids du navire et de son contenu, ainsi que de la façon dont le poids est réparti. Le poids influe globalement sur la hauteur du navire dans l’eau (franc-bord).
- Le point le plus bas où l’eau peut pénétrer (le point d’envahissement par le haut) : Ce point diffère selon la construction du navire. Pour un navire non ponté, ce point se situe normalement au sommet des pavois.
- Les espaces où des liquides, des poissons ou des éléments semblables peuvent s’accumuler et se déplacer librement avec le mouvement du navire : La présence d’eau ou de poissons sur le pont ou dans les cales constitue une menace sérieuse pour la stabilité du navire, car elle entraîne un déplacement du centre de gravité en raison de l’effet de carène liquide.
Pour être en mesure d’estimer les risques, il est important de comprendre la stabilité d’un navire et les effets des différents facteurs sur celle-ci. Pour nombre de pêcheurs, la découverte de la façon dont un navire bouge dans diverses conditions d’exploitation constitue le seul moyen de déterminer si celui-ci est stableNote de bas de page 35. Cependant, il en va tout autrement quand il s’agit de mesurer la capacité du navire à se redresser, car pour cela on doit procéder à une évaluation de la stabilité et en documenter les résultats dans un livret de stabilitéNote de bas de page 36. La réglementation exige que les évaluations de la stabilité soient effectuées par des « personnes compétentes », au sens du RSBPNote de bas de page 37. Le RA et le capitaine sont tenus de déterminer les facteurs qui influent sur la stabilité. Les rôles et responsabilités du RA sont définis dans la LMMC 2001. Contrairement aux capitaines et à d’autre personnel maritime, les RA n’ont pas besoin de certification ou de formation. Les capitaines reçoivent une formation sur la stabilité pour obtenir leur brevet. Dans l’événement à l’étude, le capitaine était titulaire d’un brevet de service, qui est basé sur les années de service et qui n’exige pas de formation sur la stabilité.
Le RSBP exige que les bateaux de pêche fassent l’objet d’une évaluation de la stabilité s’ils sont exploités dans des conditions d’embruns verglaçantsNote de bas de page 38. Ces évaluations devraient fournir des limites d’exploitation sécuritaire aux capitaines et aux équipages, notamment le franc-bord minimal à maintenir et la charge maximale de cargaison, ainsi que des séquences sécuritaires pour le chargement et l’arrimage de la cargaison et des engins et pour la gestion de l’accumulation de glace et des effets de carène liquide.
Le Bulletin de la sécurité des navires (BSN) 04/2000Note de bas de page 39 met en garde contre les dangers d’une accumulation d’eau non détectée à bord des navires de pêche et recommande l’utilisation d’alarmes de cale. Le BSN 09/2002Note de bas de page 40 décrit la nécessité d’entretenir et de mettre à l’essai les systèmes d’assèchement et de détection du niveau d’eau de cale.
La stabilité initiale du Tyhawk et les effets du pont amovible sur sa stabilité n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation officielle.
1.10.1 Construction du navire
La stabilité adéquate d’un navire commence dès sa conception et sa construction. Un navire ponté est doté d’un pont étanche fixe recouvrant la totalité de la coque au-dessus de la ligne de flottaison maximale d’exploitation et de sabords de décharge d’une superficie correspondant à au plus 4 % de celle du pavois. La flottabilité et la stabilité de ces navires sont assurées principalement par le volume de la coque se trouvant sous le pont, qui est conçu et entretenu pour être étanche. Lorsque le pont est entouré d’un pavois, le nombre de sabords de décharge dans le pavois ainsi que leur taille et leur emplacement doivent suffireNote de bas de page 41 à évacuer l’eau librement et rapidement par-dessus bord, afin d’éviter une diminution de la stabilité attribuable à l’effet de carène liquide.
Un navire non ponté n’est pas doté d’un pont étanche et dépend de la présence de pompes de cale installées sous le pont pour évacuer toute eau qui pénètre dans le navire. La flottabilité et la stabilité sont assurées par la coque étanche, qui s’étend jusqu’au sommet des pavois. Bien qu’un navire non ponté puisse être équipé de dalots permettant d’évacuer l’eau du pont lorsque celui-ci est nettoyé, les dalots sont habituellement fermés lorsque le navire est en mer et ne sont pas destinés à servir de sabords de décharge. Un navire non ponté est vulnérable à l’envahissement par les eaux lorsque les vagues passent par-dessus les bords, en particulier si son franc-bord est minimalNote de bas de page 42. Le risque d’envahissement peut être atténué en exploitant le navire dans des eaux relativement calmes et en prévoyant des moyens pour évacuer efficacement l’eau. Un navire non ponté a généralement une jauge brute de moins de 15.
Le Tyhawk a été construit comme un navire non ponté, ce qui signifie que le pont n’était pas étanche et que les pompes de cale étaient le moyen d’évacuer l’eau. Le Tyhawk était couramment exploité avec le pont amovible en place. Lorsque le navire était exploité ainsi, comme c’était le cas lors de l’inspection de 2013, l’avis de défaut de 2013 de TC indiquait que le [traduction] « pont portatif convertit la coque ouverte en coque fermée ».
1.10.2 Orientation en matière de stabilité
En prévision de l’entrée en vigueur du RSBP, TC a établi une mesure provisoire visant à déterminer si les navires de pêche inspectés d’une jauge brute de plus de 15 devaient disposer d’un livret de stabilité. Un questionnaire sur la stabilité a été présenté dans le BSN 04/2006Note de bas de page 43 à l’intention des capitaines et des RA. Ce questionnaire continue d’être utilisé pour aider les RA et les capitaines à cerner les facteurs de risque pour la stabilité et à décider des mesures à prendre en présence de ces facteurs.
Le questionnaire est divisé en 2 parties : les caractéristiques du navire (sections 1 et 2) et les exigences de stabilité, y compris les facteurs de risque (sections 3 et 4). Le questionnaire ne contient aucune orientation permettant de mettre en relation les caractéristiques du navire et les facteurs de risque pour la stabilité ou de faire référence à d’autres sources d’orientation (le questionnaire complet se trouve à l’annexe A).
La section Objet du BSN indique que les propriétaires (RA) et les capitaines sont fortement encouragés à faire évaluer la stabilité de leurs navires si un facteur de risque est relevé. Les facteurs de risque potentiels pour la stabilité sont décrits en utilisant des termes tels que « substantiel » et « significatif ».
Dans le questionnaire sur la stabilité qui a été rempli pour le Tyhawk, la présence de plusieurs ponts, de casiers et d’une bôme/grue de chargement a été indiquée dans les caractéristiques du navire, mais aucun facteur de risque pour la stabilité n’a été relevé dans les exigences de stabilité.
Indépendamment du questionnaire sur la stabilité, le BSN 01/2008Note de bas de page 44 a été publié pour expliquer les effets que les modifications peuvent avoir sur la stabilité des navires. Le BSN 01/2008 fournissait des lignes directrices sur la façon de consigner volontairement les modifications et sur le moment où la stabilité doit être évaluée. Le BSN 03/2019Note de bas de page 45 a remplacé le BSN 01/2008 et explique que, conformément au RSBP, lorsqu’un navire de pêche subit une modification importante (ou un changement dans ses activités qui risque d’en compromettre la stabilité), une évaluation de la stabilité est requise. Il a également instauré un nouveau formulaire, Registre des modifications affectant la stabilité d’un bâtiment de pêche, qui indique que les modifications de plus de 100 kg devraient être consignées et qu’une personne compétente devrait être consultée lorsque la ou les modifications créent une masse importante (une modification de 2 % du déplacement est donnée à titre indicatif). Ce BSN souligne également l’obligation de mettre à jour les procédures opérationnelles lorsqu’un navire est modifié, de tenir compte des modifications qui peuvent avoir une incidence sur la stabilité et de remettre au nouveau propriétaire tous les documents relatifs au bateau de pêche lors du transfert de propriété de ce dernier. Les directives disponibles sur les modifications apportées aux petits bâtiments commerciaux autres que les bateaux de pêche sont moins précisesNote de bas de page 46.
Il n’est pas rare qu’un navire de pêche soit modifié plusieurs fois au fil des ans, à tel point que les modifications ont une incidence sur sa stabilitéNote de bas de page 47. En 2018, TC a fourni des conseils aux propriétaires et aux exploitants pour les aider à cerner les modifications importantes ou les changements d’activité et à déterminer la stabilité adéquate Note de bas de page 48, Note de bas de page 49.
1.10.3 Ponts amovibles et stabilité
Un pont amovible peut nuire à la stabilité d’un navire pour les raisons suivantes :
- Premièrement, le poids du pont lui-même élève le centre de gravité du navire, ce qui réduit la capacité du navire à se redresser en cas de roulis.
- Deuxièmement, tout l’équipement, la cargaison et le personnel présents sur le pont amovible se trouvent plus haut sur le navire, ce qui élève encore plus le centre de gravité et réduit davantage la capacité du navire de se redresser. Une accumulation de glace ajoute également du poids plus haut sur le navire.
- Troisièmement, le pont amovible offre un espace ininterrompu sous lequel l’eau peut s’accumuler, créant un effet de carène liquide.
Les Lignes directrices relatives aux modifications importantes apportées aux bâtiments de pêche/changements d’activité Note de bas de page 50 de TC informent les pêcheurs que la présence d’un pont amovible aura une incidence négative sur la stabilité d’un navire. Le respect de ces lignes directrices est facultatif.
En utilisant le déplacement à l’état lège d’un navire de longueur, de largeur et de profondeur semblables au Tyhawk, on a estimé, dans le cadre de la présente enquête, que le pont amovible représentait près de 8 % du déplacement à l’état lège du bateau.
1.11 Sécurité de la pêche
La sécurité de la pêche est la responsabilité du RA, du capitaine et de l’équipage du navire. La sécurité de la pêche est régie et influencée par d’autres, tels que TC, le MPO et les organismes provinciaux responsables de la sécurité au travail. Les pêcheurs doivent interagir avec TC pour obtenir des documents maritimes canadiens pour leurs navires et leurs équipages et démontrer leur conformité à la réglementation. Les pêcheurs doivent également interagir avec le MPO pour obtenir des permis et déclarer leurs prises et leurs activités comme il se doit. Les pêcheurs peuvent également faire partie des comités consultatifs et décisionnels du MPO.
Le RA d’un navire doit agir à l’égard de toute question relative au navire dont aucune autre personne n’est responsable au titre de la LMMC 2001. Plus précisément, les RA sont chargés de veiller à ce que le navire ainsi que ses machines et son équipement respectent la réglementation, d’élaborer des procédures d’exploitation sécuritaire du navire et en cas d’urgence et de s’assurer que les membres d’équipage reçoivent une formation en matière de sécuritéNote de bas de page 51. Le capitaine d’un navire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité du navire et des personnes qui sont à son bordNote de bas de page 52. De plus, le RSBP indique que le capitaine et le RA sont tous deux chargés de veiller au respect de la réglementationNote de bas de page 53.
L’Enquête sur les questions de sécurité relatives à l’industrie de la pêche au Canada (SII sur la sécurité de la pêche) du BSTNote de bas de page 54, un examen national exhaustif des questions de sécurité relatives à l’industrie de la pêche, a permis de révéler les relations complexes et les interdépendances qui existent entre elles. La SII sur la sécurité de la pêche a permis de mettre en évidence 10 questions de sécurité importantes qui sont interreliées et qui requièrent une attention particulière, parmi lesquelles certaines sont analysées dans le cadre de l’événement à l’étude :
- stabilité des navires, modifications apportées aux navires et connaissance des principes de stabilité;
- approche de réglementation de la sécurité;
- pratiques de travail lors des activités liées à la pêche;
- comment les mesures de gestion des pêches permettent de déterminer et de réduire les risques pour la sécurité.
D’autres conditions dangereuses relevées dans la SII sur la sécurité de la pêche ont également été notées, mais n’ont pas été analysées dans le cadre de l’enquête sur l’événement à l’étude (annexe B). La sécurité des pêcheurs continuera d’être compromise tant que le milieu de la pêche ne reconnaîtra pas les relations complexes et les interdépendances entre les questions de sécurité et n’y donnera pas suite.
1.11.1 Collaboration entre Pêches et Océans Canada et Transports Canada
TC, le MPO et la Garde côtière canadienne ont signé le Protocole d’entente entre Pêches et Océans Canada (MPO) et Transports Canada (TC) en ce qui concerne la sécurité en mer des pêcheurs commerciaux (le PE) afin d’assurer une collaboration en matière de sécurité en mer des pêcheurs commerciaux. Le PE a été signé pour la première fois en 2006, puis mis à jour en 2015 Note de bas de page 55. Il stipule que chacun de ces organismes participants doit établir des principes visant à promouvoir une culture de sécurité et tenir compte de la sécurité des pêcheurs au moment de créer ou de réviser des règles, règlements, politiques ou plans qui les concernent. Toujours d’après ce PE, ces organismes doivent se réunir, au besoin, pour discuter des questions de sécurité relatives aux bateaux de pêche. Tous les organismes nationaux et régionaux participants doivent discuter des questions de sécurité dans le cadre de ce processus de consultation. Les résultats de ces discussions doivent être pris en compte dans les documents tels les plans de gestion intégrée des pêches (PGIP) du MPO, le cas échéant Note de bas de page 56.
Bien que le MPO n’ait pas de politique sur la sécurité des pêches, il reconnaît avoir un rôle à jouer quant à l’intégration de la sécurité dans l’élaboration des plans et des politiques de gestion des pêches Note de bas de page 57.
1.12 La pêche au crabe des neiges
La pêche au crabe des neiges revêt une importance pour les pêcheurs de l’Atlantique. Il s’agit de la première pêche de l’année pour de nombreux pêcheurs, dont ceux de la Première Nation d’Elsipogtog.
La pêche au crabe des neiges dans le sud du golfe du Saint-Laurent est répartie en plusieurs zones de prise, appelées zones de pêche au crabeNote de bas de page 58. Les captures ne peuvent être débarquées que dans certains ports désignés, qui sont indiqués sur le permis de pêcheNote de bas de page 59. La zone 12, où le Tyhawk pêchait, ouvre généralement entre la mi-avril et le début du mois de mai. La pêche au crabe des neiges dans la zone 12 commence souvent à minuit le jour de l’ouverture.
Dans le cadre de la pêche au crabe des neiges, le total admissible des captures (TAC) est fixé pour toute la zone 12. Les communautés autochtones reçoivent des permis communautairesNote de bas de page 60. Les titulaires de permis communautaires se voient attribuer un pourcentage du TAC et peuvent répartir les casiers entre les bateaux désignés de la façon qui leur est la plus favorable; un maximum de 150 casiers par bateau est imposé. En 2020, la Première Nation d’Elsipogtog a désigné 29 bateaux pour la pêche au crabe des neiges, notamment le Tyhawk et le Lady Margaret I. En 2021, la Première Nation d’Elsipogtog a désigné 27 bateaux pour la pêche au crabe des neiges, notamment le Tyhawk, mais pas le Lady Margaret I. Les casiers du Lady Margaret I ont été attribués au Tyhawk et le prix à la livre perçu par l’équipage a été fixé à un montant plus élevé parce que leurs allocations ont été combinées.
1.12.1 Plans et mesures de Pêches et Océans Canada
Le rôle du MPO est de protéger et de gérer les pêches du Canada, de créer des possibilités économiques pour les collectivités côtières et les pêches, ainsi que de protéger et de restaurer les océans et les écosystèmes marins du Canada Note de bas de page 61. Pour s’acquitter de son rôle, le MPO établit des politiques et participe à des accords internationaux; élabore, met en œuvre et gère les mesures et les décisions relatives aux pêches (y compris les mesures de protection); et fait appliquer les mesures de gestion des ressources halieutiques (GRH). La Garde côtière canadienne, qui fournit des services de recherche et de sauvetage, entre autres, fait également partie du MPO.
L’élaboration et la mise en œuvre d’un PGIP, qui est approuvé par le ou la ministre, est l’un des processus clés de la gestion des pêches. Dans la plupart des pêches, un PGIP est pluriannuel. Un PGIP vise à définir et à communiquer les objectifs propres à une pêche, y compris l’allocation et la gestion du TAC et la gestion de l’équipement; les mesures de gestion particulières à prendre pour assurer la pérennité de la ressource; ainsi que d’autres lois, règlements et politiques applicables. Un PGIPNote de bas de page 62 est élaboré dans le cadre d’un processus de consultation complexe. Cette consultation réunit notamment des intervenants du secteur, des pêcheurs, des communautés des Premières Nations, ainsi que des scientifiques des écosystèmes et des océans et tient compte de facteurs scientifiques, sectoriels et socioéconomiques. Le MPO recommande aux gestionnaires de ressources d’inclure une section sur la sécurité en mer dans leur PGIP, cependant cette section ne figure pas dans tous les plans. Dans certaines régions, les défenseurs de la sécurité tels que TC et les organismes responsables de la sécurité au travail participent à l’élaboration de la section sur la sécurité en mer.
La zone dans laquelle le Tyhawk pêchait est gérée par le PGIP du crabe des neiges dans le sud du golfe du Saint-LaurentNote de bas de page 63 et chevauche l’habitat de la baleine noire de l’Atlantique Nord (BNAN), qui est une espèce en périlNote de bas de page 64. La BNAN est menacée par le bruit des navires, les perturbations et les collisions, les blessures et la mortalité attribuables à l’empêtrement dans des engins de pêche, ainsi que par la modification et la perte de son habitat. En 2017, après 17 incidents survenus dans le golfe du Saint-Laurent et mettant en cause des BNAN (12 morts et 5 empêtrements), le MPO a procédé à la fermeture précoce de la pêche au crabe des neiges dans le golfe du Saint-Laurent, à titre de mesure de protection d’urgenceNote de bas de page 65. À partir de 2018, des mesures de gestion des pêches ont été créées pour protéger la BNAN, y compris des fermetures temporaires et l’exploration de nouvelles technologies et méthodes de pêche. Dans le cas de la pêche au crabe des neiges, ces mesures de protection comprenaient également la modification de la date de fermeture de la saison, ce qui a eu pour effet de raccourcir la saison de près du tiers. Les mesures de protection ont été élaborées avec la participation et les conseils du MPO, de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-UnisNote de bas de page 66, de TC et de représentants de l’industrie.
Une fois approuvé, le PGIP est examiné par le Comité consultatif de crabe des neiges du sud du golfe du Saint-Laurent. Le comité consultatif est composé de représentants de divers secteurs de l’industrie de la pêche, y compris TC quand il est invité, et se réunit pour offrir un forum de consultation sur des questions telles que le TAC et d’autres mesures de gestion et pour conseiller le ou la ministre des Pêches et des Océans. Lors de la réunion du comité consultatif tenue en 2021, TC a présenté un exposé sur l’immatriculation des navires. Le comité consultatif met à jour le cadre de référence du Comité d’établissement de la date d’ouverture de la pêche au crabe des neiges dans la zone 12 (un sous-comité), qui définit le protocole de proposition de la date d’ouverture de la saison.
En 2018, une table ronde panatlantique sur les BNAN a été organisée pour permettre aux participants de formuler des suggestions et des conseils à prendre en compte lors de l’élaboration des mesures de protection de 2019. Parmi les participants figuraient des représentants de l’industrie de la pêche de l’ensemble du Canada atlantique et la ministre des Pêches et des Océans. Une suggestion était d’ouvrir la pêche au crabe des neiges 10 à 15 jours plus tôt afin de permettre aux pêcheurs d’effectuer leurs captures avant l’arrivée des BNAN. En 2020, afin de réduire les répercussions économiques de la fermeture précoce de la saison, le comité consultatif a modifié le cadre de référence pour encourager le sous-comité à ouvrir la pêche le plus tôt possible.
1.12.2 Décision annuelle pour la date d’ouverture de la saison de la pêche au crabe des neiges
La date d’ouverture de la saison est fixée par le MPO sur proposition du sous-comité. Le cadre de référence du sous-comité comprend son mandat, sa composition et les facteurs de sécurité à prendre en considération pour l’ouverture. En 2021, ce sous-comité était composé de 17 membres. Parmi les 17 membres, 13 provenaient de l’industrie et les 4 autres du gouvernement (annexe C). L’industrie est chargée de présider les réunions, auxquelles d’autres participants peuvent être invités si nécessaire. En 2021, la personne responsable des pêches de la Première Nation d’Elsipogtog comptait parmi les membres.
Le sous-comité coordonne les activités liées à l’ouverture de la saison et veille à ce que l’ouverture se déroule de la manière la plus sécuritaire possible. Le cadre de référence exige que le sous-comité tienne compte chaque année des facteurs de sécurité suivants :
- l’état des glaces dans le sud du golfe du Saint-Laurent;
- l’accès libre de glace aux quais désignés pour le débarquement du crabe des neiges (pour lesquels le MPO déploie tous les efforts nécessaires pour fournir des services de déglaçage);
- les prévisions relatives à la vitesse du vent et aux embruns verglaçants.
Lors de la dernière réunion du sous-comité, le 1er avril 2021Note de bas de page 67, un consensus a été atteint et une date qui était presque 3 semaines plus tôt que les dates des 4 années précédentes a été proposée.
Le procès-verbal de la réunion indiquait que 2 membres ont exprimé des préoccupations au sujet de la date d’ouverture proposée pour des motifs de sécurité et de préparation, compte tenu des conditions météorologiques prévues et de l’état des glaces à leur port d’attache. Le sous-comité a conclu que le cadre de référence n’exigeait pas que tous les ports soient libres de glace et qu’il incombait toujours aux capitaines de s’assurer que la navigation était sûre le jour de l’ouverture.
Le MPO exige un préavis de 48 heures avant la date d’ouverture convenue. Une fois que le sous-comité a proposé une date d’ouverture de la saison, le MPO examine la proposition, les conseils et les prévisions météorologiques 36 heures avant ladite date, puis il prend la décision finale. Le MPO ne tient pas de compte rendu des discussions qui ont lieu lors de ces réunions finales.
En 2021, les prévisions météorologiques répondaient aux critères d’ouverture de la saison et la pêche a été ouverte le 3 avril. Le tableau 1 présente les dates d’ouverture de la pêche de 2017 à 2021.
| Année | Dates prévues de la saison | Durée prévue de la saison (en jours) | Durée réelle de la saison (en jours) |
|---|---|---|---|
| 2017 | Du 25 avril au 28 juillet | 95 | 87 |
| 2018 | Du 29 avril au 1er juillet | 64 | 64 |
| 2019 | Du 2 mai au 1er juillet | 61 | 61 |
| 2020* | Du 24 avril au 1er juillet | 69 | 69 |
| 2021 | Du 3 avril au 30 juin | 89 | 89 |
*En 2020, il y a eu une fermeture temporaire dans une partie de la zone de pêche, qui a commencé le 16 mai et a duré 15 jours.
1.13 Gestion des risques
Gérer les risques signifie de prendre des décisions sur la façon d’atténuer ou d’éliminer les risques qui ont été cernés et évalués. Les étapes générales de l’évaluation des risques consistent à poser les questions suivantes Note de bas de page 68 :
- Qu’est-ce qui pourrait mal tourner? (déterminer les dangers)
- Quelle pourrait être la gravité des effets? Quelle est leur probabilité? (évaluer les risques)
- Peut-on apporter des améliorations? (analyser les mesures de contrôle des risques)
- Combien cela coûterait-il et dans quelle mesure cela serait-il mieux? (effectuer une évaluation coûts-avantages)
- Quelles mesures devraient être prises? (formuler des recommandations aux décideurs)
Il existe 4 façons de gérer les risques recensés : le transfert, l’élimination, l’acceptation ou l’atténuation. Une fois que les risques sont gérés, il est important d’évaluer les risques résiduels découlant des mesures choisies. Dans le contexte des mesures et des décisions relatives à la GRH, par exemple, cela signifie que toute mesure visant à réduire les dommages causés à une espèce ou à protéger les revenus doit faire l’objet d’une évaluation plus approfondie afin de déterminer les risques résiduels.
Ces étapes générales de gestion des risques sont linéaires et fonctionnent bien dans des situations simples. La complexité et la fréquence des décisions prises en fonction des risques jouent un rôle dans la façon dont les risques sont gérés.
Dans des situations plus complexes, des dangers sont présents dans plusieurs domaines, interagissant et créant des dangers supplémentaires. De plus, les dangers peuvent avoir une incidence différente sur les personnes touchées par la situation. Lorsque la situation est complexe, l’évaluation des risques doit être plus exhaustive, prenant en compte de multiples préoccupations et pressions, y compris les interactions et les effets cumulatifs. En outre, il est important de veiller à inclure une expertise indépendante dans tous les domaines pertinents. Les situations auxquelles est confronté le MPO sont complexes et les décisions en matière de GRH doivent tenir compte aussi bien des préoccupations d’ordre économique que de celles liées à la conservation et à la sécurité. Dans l’événement à l’étude, outre ces préoccupations, les pressions internationales et les contraintes de temps liées aux mesures de protection des BNAN ont accru la complexité des décisions.
En présence de situations de routine, les dangers sont généralement déjà bien cernés et évalués. Par conséquent, on peut se fier aux résultats des étapes précédentes de détermination des dangers et d’évaluation des risques et, dans le cadre de la gestion des risques, on peut se concentrer sur les étapes de l’évaluation coûts-avantages et des recommandations. Le MPO procède régulièrement à l’ouverture de saisons de pêche. Ainsi, la décision relative à l’ouverture de la saison de pêche au crabe des neiges de 2021 a été gérée comme une situation de routine plutôt que comme une nouvelle situation. Les nouvelles situations bénéficient également d’une évaluation complète des risques.
1.13.1 Détermination des dangers
La qualité d’une évaluation des risques dépend de l’exhaustivité de l’étape de détermination des dangers. Pour recenser l’ensemble des dangers, il faut dresser une liste de tous les scénarios pertinents accompagnés de leurs causes potentielles, de leurs facteurs contributifs et de leurs conséquences, puis énumérer les dangers et les risques qui y sont associés. Pour que cette étape soit efficace, il faut consulter et prendre en compte un large éventail de sources d’information sur les risques, telles que les incidents antérieurs, les avis d’experts et les directives réglementaires.
La capacité de détecter et de déterminer les dangers dépend en particulier de la compréhension et de la tolérance au risque qu’a l’équipe chargée de l’évaluation des risques Note de bas de page 69. La perception du risque et la tolérance à celui-ci sont influencées par de nombreux facteurs, notamment la nature de l’activité dangereuse, la pression exercée pour accepter le risque, les expériences locales et mondiales, ainsi que les résultats et les conséquences des décisions antérieures.
1.13.2 Prise de décisions
Les risques associés à chaque danger doivent être évalués en fonction des conséquences possibles si des personnes ou des biens sont exposés aux dangers. Pour ce faire, on définit la probabilité et la gravité d’une conséquence qui pourrait résulter du danger. Pour que la prise de décisions soit efficace, il faut comprendre les critères clairs qui définissent le niveau de risque acceptable. Ce principe s’applique tant aux risques qu’aux risques résiduels.
1.14 Immersion en eau froide
En mer, les membres d’équipage risquent d’être exposés aux dangers liés à l’immersion dans l’eau. Les principaux effets sont causés par l’exposition à l’eau froide (eau de 15 °C ou moins) et l’ingestion d’eau. Si une personne entre dans l’eau, l’immersion est suivie des effets physiques et psychologiques suivants Note de bas de page 70 :
- L’inspiration d’une profonde bouffée d’air, puis une hyperventilation provoquant de légers spasmes musculaires, se produisent dans les 2 premières minutes (réaction au choc hypothermique). Si la bouche de la personne est sous l’eau, de l’eau est aspirée dans ses poumons. Il peut également y avoir une augmentation rapide et importante de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, en particulier chez les personnes âgées ou en moins bonne santé.
- Les muscles sont atteints dans un délai de 5 à 30 minutes (incapacité attribuable au froid). Les petits muscles des mains peuvent être les premiers touchés, ce qui réduit la capacité à mettre un dispositif de flottaison ou à s’y agripper. On observe également un affaiblissement progressif des fonctions cognitives.
- Le corps commence à se refroidir (hypothermie). Il faut en général au moins 30 minutes pour que les effets de l’hypothermie se manifestent pleinement.
- Chez certaines personnes, il peut y avoir une dégradation de la capacité de penser et une perte d’efficacité (baisse des capacités cognitives), attribuables à des états tels que la confusion, l’anxiété paralysante, la stupeur ou la désorientation. D’autres réactions corporelles peuvent alors se produire en raison de la confusion, de l’anxiété ou d’états semblables, tels qu’un rythme cardiaque rapide, des tremblements, la faiblesse et des nausées, qui peuvent tous exacerber les effets de l’immersion en eau froide, en particulier l’hyperventilation, ce qui augmentera la probabilité d’ingestion d’eau.
L’un ou l’autre de ces effets peut entraîner la noyade de la personne.
Les radeaux de sauvetage, les gilets de sauvetage, les vêtements de flottaison individuels (VFI) et les combinaisons d’immersion sont des engins de sauvetage qui protègent contre les effets de l’immersion en eau froide. Le RSBP exige la présence de gilets de sauvetage et de VFI à bord des navires. Les gilets de sauvetage sont conçus pour être portés en cas d’abandon du navire, alors que les VFI sont conçus pour être utilisés de manière continue lors des travaux sur le pont. La réglementation fédérale Note de bas de page 71 exige que les pêcheurs portent un VFI ou un gilet de sauvetage s’ils sont exposés à un risque. Cependant, de nombreux pêcheurs continuent de travailler sur le pont sans porter de VFI, car ils ne trouvent pas leur port pratique, normal ou nécessaire Note de bas de page 72. En outre, le RSBP exige que les navires qui effectuent des voyages à proximité du littoral, classe 2, aient à leur bord un radeau de sauvetage d’une capacité suffisante pour transporter le nombre de personnes à bord, une RLS et une combinaison d’immersion ou une combinaison de travail isotherme pour chaque personne à bord si la température de l’eau est inférieure à 15 °C Note de bas de page 73. Les radeaux de sauvetage doivent être rangés de manière à flotter librement si le navire coule Note de bas de page 74.
Le Tyhawk avait des VFI et des gilets de sauvetage à son bord. Les membres d’équipage pêchaient sans porter de VFI. Le Tyhawk transportait un radeau de sauvetage pour 6 personnes qui était entreposé non arrimé à l’arrière de la timonerie.
1.15 Fatigue et inertie du sommeil
La fatigue peut entraîner une détérioration au niveau du fonctionnement cognitif général, de la résolution de problèmes, de la prise de décisions, de la mémoire, de l’attention, de la vigilance et du temps de réaction. Lorsqu’une personne est fatiguée, il lui faut plus de temps pour percevoir, interpréter et comprendre les événements courants et les situations d’urgence, et pour y réagir Note de bas de page 75.
La fatigue est très répandue dans l’industrie de la pêche en raison de nombreux facteurs, notamment la charge de travail élevée des équipages, les pratiques d’exploitation dangereuses, les conditions météorologiques défavorables et la sensibilisation insuffisante à la fatigue et à ses effets. Il est rare que les pêcheurs aient reçu une formation sur les facteurs de risque liés à la fatigue, les conditions d’exploitation qui contribuent à la fatigue et les stratégies de gestion de la fatigue, et une telle formation n’est pas obligatoire pour les équipages. TC a établi des exigences relatives aux heures de travail et de repos, mais celles-ci ne s’appliquent pas aux navires de pêche d’une jauge brute de moins de 100 Note de bas de page 76.
L’inertie du sommeil est une période de confusion et de diminution de la vigilance après un réveil soudain. L’inertie du sommeil altère les capacités cognitives essentielles de vigilance et de vivacité d’esprit nécessaires à la prise de décisions rationnelles et peut réduire le rendement décisionnel pendant une période pouvant aller jusqu’à 30 minutes Note de bas de page 77. Plusieurs facteurs de fatigue influent sur l’inertie du sommeil, en particulier la phase de sommeil avant l’éveil et la privation de sommeil antérieure Note de bas de page 78.
L’examen des facteurs de risque suivants peut permettre de déterminer la probabilité qu’un membre d’équipage ait été fatigué au moment d’un événement : perturbation aiguë du sommeil, perturbation chronique du sommeil, état de veille continue ou prolongé, effets du rythme circadien, troubles du sommeil, problèmes médicaux ou psychologiques et maladies ou médicaments susceptibles d’entraîner de la fatigue.
La perturbation aiguë du sommeil est causée par des réductions importantes de la quantité ou de la qualité du sommeil. Normalement, on considère que la quantité de sommeil est réduite de manière importante lorsque cette réduction est d’une durée d’au moins 30 minutes. Les réveils ou d’autres modifications importantes de la structure normale du sommeil d’une personne peuvent nuire à la qualité de son sommeil. En présence d’une perturbation aiguë du sommeil, 22 heures d’éveil constituent la limite supérieure à partir de laquelle presque tous les aspects de la performance humaine diminuent en raison de la fatigue Note de bas de page 79, bien que les premiers signes d’affaiblissement puissent apparaître après 17 heures d’éveil continu. De plus, étant donné que le besoin biologique de sommeil est beaucoup plus fort pendant la nuit que pendant le jour, la fatigue peut être présente à la suite de moins d’heures d’éveil continu ou prolongé lorsque ces heures d’éveil surviennent la nuit plutôt que le jour, même pour les travailleurs de nuit réguliers Note de bas de page 80.
Le sommeil réparateur est nécessaire pour lutter contre la fatigue liée à l’un ou à l’ensemble de ces facteurs de risque. Pour que le sommeil soit réparateur, il doit se dérouler la nuit sur une période d’au moins 7 heures continues, et pouvant aller jusqu’à 9 heures continues Note de bas de page 81.
La sieste (repos contrôlé) est une mesure efficace pour contrer les effets de la fatigue lorsqu’elle est utilisée dans le cadre d’une stratégie ou d’un système de gestion de la fatigue. La sieste, même pour une période aussi courte que de 10 à 30 minutes, peut être réparatrice et réduire le risque d’affaiblissement des facultés attribuables à la fatigue si elle est prise dans des conditions appropriées (p. ex., dans un environnement propice à la sieste) Note de bas de page 82. Il s’agit toutefois d’une stratégie temporaire de gestion de la fatigue. Les siestes ponctuelles et non contrôlées ainsi que l’endormissement spontané ne sont pas considérés comme du sommeil réparateur. La SII sur la sécurité de la pêche a permis de constater que les pêcheurs acceptent la fatigue comme un aspect normal de leurs activités et ne reconnaissent généralement pas les signes de fatigue.
Pendant une partie du voyage à l’étude, le membre d’équipage 1 assurait le quart pendant que les autres membres d’équipage et le capitaine faisaient la sieste. Les emménagements de l’équipage à bord du Tyhawk n’étaient pas optimaux pour obtenir un sommeil réparateur. Lors du 1er voyage, il y avait 4 couchettes pour les 9 personnes à bord. Il faisait très froid dans les emménagements lors des 2 voyages.
Les membres d’équipage 1 et 2 étaient réveillés lorsqu’on a remarqué pour la première fois que de l’eau s’accumulait dans le compartiment moteur. Le capitaine et les autres membres d’équipage ont été réveillés alors que le bateau faisait route vers les lieux de pêche. Au moment où le bateau a chaviré, le capitaine était éveillé depuis environ 37 heures et les membres d’équipage depuis environ 34 heures, à l’exception de quelques siestes nécessaires, mais courtes, de mauvaise qualité et non contrôlées, pendant cette période.
1.16 Facteurs médicaux
En décembre 2018, à la suite de la légalisation du cannabis, TC a diffusé le BSN 12/2018, Légalisation du cannabis au Canada et conduite des bâtiments Note de bas de page 83. L’objectif de ce BSN est de rappeler aux RA et aux gens de mer qu’ils ont la responsabilité d’exploiter les navires en toute sécurité, ainsi que leur rappeler les effets du cannabis sur la performance humaine.
La consommation de drogues et d’alcool à bord des bateaux de pêche est une source de préoccupation croissante pour les membres de l’industrie de la pêche. Pendant l’enquête, il a été signalé que du cannabis était consommé à bord du Tyhawk. Il n’y a pas de dépistage obligatoire des drogues et de l’alcool après un accident pour les personnes touchées par un événement, ce qui limite la capacité de déterminer si les drogues et l’alcool ont été un facteur dans ce dernier Note de bas de page 84.
1.17 Événements antérieurs
En 10 ans Note de bas de page 85, le BST a enquêté sur 19 événements semblables à celui du Tyhawk, qui ont fait 34 morts. Ces enquêtes ont permis de cerner des facteurs qui compromettent la stabilité des navires, tels que la réduction du franc-bord, l’élévation du centre de gravité, les modifications et les effets de carène liquide Note de bas de page 86.
Au cours de la même période, le BST a enregistré 7 autres événements qui ont conduit à la mort de 11 pêcheurs Note de bas de page 87 et qui étaient probablement liés à des problèmes de stabilité. Toutefois, aucun rapport d’enquête n’a été publié pour ces événements.
1.18 Recommandations actives
1.18.1 Recommandations sur la stabilité et sur les vêtements de flottaison individuels
Les petits bateaux de pêche Note de bas de page 88 représentent plus de 99 % de la flotte canadienne complète de navires de pêche immatriculés auprès de TC. La plupart de ces bateaux de pêche, tels que le Tyhawk, sont exemptés de l’obligation de faire l’objet d’une évaluation de la stabilité ou de mettre à la disposition de l’équipage des directives compréhensibles en matière de stabilité reposant sur une telle évaluation. À la suite d’un événement survenu le 5 septembre 2015 au cours duquel le grand bateau de pêche Caledonian a soudainement chaviré à 20 NM à l’ouest du détroit Nootka (Colombie-Britannique) et 3 membres d’équipage sont morts Note de bas de page 89, le Bureau a recommandé que
le ministère des Transports exige que tous les petits bateaux de pêche fassent l’objet d’une évaluation de stabilité et établisse des normes pour faire en sorte que les renseignements sur la stabilité soient pertinents et que l’équipage y ait facilement accès.
Recommandation M16-03 du BST
Le Bureau a également conclu que les pêcheurs exercent souvent leurs activités dans de rudes conditions environnementales et physiques, et que le risque de tomber à l’eau est élevé. Les enquêtes du BST ont montré que le port d’un VFI accroît les chances de survie des personnes qui tombent à l’eau. Par conséquent, le Bureau a aussi recommandé que
le ministère des Transports exige que les personnes portent les vêtements de flottaison individuels appropriés en tout temps lorsqu’elles se trouvent sur le pont d’un bâtiment de pêche commerciale ou à bord d’un bâtiment de pêche commerciale non ponté ou sans structure de pont et que le ministère des Transports veille à l’élaboration de programmes visant à confirmer la conformité.
Recommandation M16-05 du BST
Dans le cas du Tyhawk, les modifications apportées au bateau n’ont pas été évaluées quant à leurs effets sur la stabilité.Les facteurs liés à la stabilité ont joué un rôle important dans de nombreux accidents de bateaux de pêche depuis 1990. De plus, au moment de l’événement, aucun membre d’équipage du Tyhawk ne portait de VFI.
Depuis la publication de la recommandation M16-03, le BST a assuré un suivi annuel auprès de TC sur les mesures prises pour y donner suite. Dans le cadre de sa réponse à la recommandation M16-03 en décembre 2022, TC énumère de nombreuses initiatives visant à améliorer la sécurité de la pêche. Cependant, ces initiatives touchent principalement les navires d’une jauge brute de plus de 15, plutôt que les nombreux petits bateaux de pêche dont la stabilité n’a pas été évaluée. Les initiatives comprennent la CIC de TC portant sur les bateaux de pêche. La CIC visait les navires de toutes tailles, mais la majorité d’entre eux étaient des navires dont la jauge brute se situait entre 15 et 150. La CIC a mis en évidence « la stabilité et les modifications » en tant que domaine où des mesures devaient être prises, ce que TC abordera en élaborant de nouveaux documents de sensibilisation, en examinant les outils actuels mis à la disposition des inspecteurs de la Sécurité maritime et en mettant à jour ses processus.
Au moment de la rédaction du présent rapport, le Bureau estimait que la réponse à la recommandation M16-03 dénotait une attention non satisfaisante Note de bas de page 90. TC a déclaré qu’il n’a pas l’intention de prendre d’autres mesures réglementaires pour rendre les évaluations de la stabilité obligatoires pour tous les petits bateaux de pêche, et qu’il se concentrera sur les possibilités d’éducation et de sensibilisation.
Dans sa réponse de décembre 2022 à la recommandation M16-05, TC a indiqué qu’il appuyait les campagnes d’éducation et de sensibilisation en milieu de travail menées par diverses provinces et par l’industrie de la pêche, mais qu’il estimait que le port des VFI à bord en toutes circonstances exigeait un changement de la culture de sécurité dans l’industrie de la pêche. TC a également indiqué qu’il prendra de mesures pour réduire le risque de chute par-dessus bord grâce à des dispositions réglementaires à la phase 2 du RSBP. Ces dispositions comprendraient le port obligatoire de VFI sur les navires de pêche dont le pont est exposé, à moins qu’il n’y ait des garde-corps d’une hauteur précise, l’utilisation d’un harnais pour des activités spécifiques et l’utilisation de peinture antidérapante sur les ponts.
L’absence d’une exigence réglementaire sur le port d’un VFI laisse aux personnes la responsabilité de déterminer ce qui constitue une situation dangereuse. Par conséquent, les pêcheurs demeurent vulnérables aux changements rapides dans les circonstances, telles qu’un changement soudain des conditions météorologiques ou une panne d’équipement. De plus, les membres d’équipage qui ne portent pas de VFI se retrouveraient sans protection s’ils tombent à l’eau.
Au moment de la rédaction du présent rapport, le Bureau estimait que la réponse à la recommandation M16-05 dénotait une attention en partie satisfaisante Note de bas de page 91.
En juin 2016, le petit bateau de pêche C19496NB pêchait le homard avec 3 personnes à son bord lorsque le bateau a rapidement commencé à prendre l’eau et a chaviré à environ 0,5 NM du quai de Miller Brook, à Salmon Beach (Nouveau-Brunswick). Deux membres d’équipage y ont perdu la vie. Il a été établi qu’aucun des membres d’équipage ne portait de gilet de sauvetage ou de VFI Note de bas de page 92 lorsque le bateau a chaviré. Étant donné que le chavirement s’est produit rapidement, les membres d’équipage n’ont pas eu le temps de prendre et d’enfiler les gilets de sauvetage rangés à bord du bateau Note de bas de page 93.
Le BST est d’avis que la mise en œuvre d’exigences explicites relatives au port de VFI par les pêcheurs réduirait considérablement le nombre de pertes de vie attribuables aux chutes par-dessus bord et il a déjà fait des recommandations semblables à TC et à Travail sécuritaire NB. En 2017, le Bureau a également recommandé que
le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Travail sécuritaire NB exigent que les personnes portent les vêtements de flottaison individuels appropriés en tout temps lorsqu’elles se trouvent sur le pont d’un bâtiment de pêche commerciale ou à bord d’un bâtiment de pêche commerciale non ponté ou sans structure de pont, et que Travail sécuritaire NB veille à l’élaboration de programmes visant à confirmer la conformité.
Recommandation M17-04 du BST
Dans l’événement mettant en cause le Tyhawk, la situation s’est rapidement aggravée et les membres d’équipage n’ont pas eu le temps de prendre et d’enfiler les gilets de sauvetage, les VFI ou les combinaisons d’immersion rangés à bord du bateau.
Les réponses du Nouveau-Brunswick et de Travail sécuritaire NB font état des efforts continus pour élaborer une campagne d’éducation, de sensibilisation et de formation qui met notamment l’accent sur l’importance des VFI. À compter du 1er juin 2024, des modifications à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail de la province comprendront l’ajout des bateaux de pêche à la définition de « lieu de travail » et exigeront le port de VFI à bord des bateaux de pêche.
Le Bureau estime que la réponse à la recommandation M17-04 dénote une intention satisfaisante Note de bas de page 94.
1.18.2 Fatigue
À la suite d’un événement survenu le 13 octobre 2016, au cours duquel le remorqueur Nathan E. Stewart et le chaland-citerne DBL 55 se sont échoués après que l’officier de quart à la passerelle, qui était fatigué, s’est endormi Note de bas de page 95, le Bureau a formulé 2 recommandations liées à la fatigue. Dans la première, le Bureau a recommandé que
le ministère des Transports exige que les officiers de quart dont les périodes de travail et de repos sont régies par le Règlement sur le personnel maritime participent à un cours pratique sur la fatigue et une formation en sensibilisation pour les aider à reconnaître et à atténuer les risques de fatigue.
Recommandation M18-01 du BST
Dans sa deuxième recommandation, le Bureau a recommandé que
le ministère des Transports oblige les exploitants de navires qui emploient des officiers de quart dont les périodes de travail et de repos sont régies par le Règlement sur le personnel maritime à mettre en œuvre un programme de gestion de la fatigue complet et adapté à leurs activités, et ce, pour réduire les risques de fatigue.
Recommandation M18-02 du BST
Dans l’événement de 2016, les 2 recommandations visaient la gestion de la fatigue chez les officiers de quart. Dans l’événement mettant en cause le Tyhawk, la fatigue n’a pas été gérée et l’équipage était probablement fatigué au moment de l’événement.
En réponse à ces recommandations, TC a mis en œuvre un plan d’action quinquennal sur la fatigue pour lutter contre la fatigue chez les gens de mer. TC a également proposé des modifications au Règlement sur le personnel maritime. Toutefois, la publication du nouveau Règlement sur le personnel maritime dans la Partie I de la Gazette du Canada a été considérablement retardée. En plus, les bateaux de pêche d’une jauge brute de moins de 100, comme le Tyhawk, sont exemptés des exigences en matière de travail et de repos. Au moment de la rédaction du présent rapport, on estimait que la réponse de TC à la recommandation M18-01 dénotait une intention satisfaisante et que la réponse de TC à la recommandation M18-02 dénotait une attention non satisfaisante.
1.19 Liste de surveillance du BST
La Liste de surveillance du BST énumère les principaux enjeux de sécurité qu’il faut s’employer à régler pour rendre le système de transport canadien encore plus sûr.
La sécurité de la pêche commerciale figure sur la Liste de surveillance 2022. Le Bureau a inscrit cet enjeu à la Liste de surveillance en 2010. Chaque année, les mêmes lacunes de sécurité et les mêmes pratiques de travail dangereuses à bord des bateaux de pêche continuent de mettre en péril la vie de milliers de pêcheurs canadiens ainsi que les moyens de subsistance de leur famille et de leur communauté. De 2018 à 2020, 45 pêcheurs ont perdu la vie, ce qui représente le nombre de morts le plus élevé pour une période de 3 ans depuis plus de 20 ans. Cet événement mettant en cause le Tyhawk témoigne des problèmes persistants en matière de surveillance réglementaire en ce qui a trait aux pratiques de travail dangereuses, à la mise en œuvre d’exigences en fonction des estimations et des mesures du jaugeage et aux modifications apportées aux navires.
MESURES À PRENDRE L’enjeu de la sécurité de la pêche commerciale demeurera sur la Liste de surveillance jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d’indices qu’une saine culture de sécurité s’est établie à l’échelle de l’industrie et dans les communautés de pêcheurs partout au pays, notamment :
|
La gestion de la fatigue dans le transport ferroviaire, maritime et aérien figure sur la Liste de surveillance 2022.
Les dispositions sur les périodes de travail et de repos dans le Règlement sur le personnel maritime ne s’appliquent pas à environ 95 % des navires de pêche; de plus, il n’y a aucune exigence dans le règlement relative à une formation complète de sensibilisation à la fatigue ou aux plans de gestion de la fatigue. Compte tenu des longues heures de travail et de l’effort physique et mental qu’exige la pêche commerciale, il importe que les pêcheurs soient sensibilisés davantage aux risques liés à la fatigue et puissent recourir à des stratégies efficaces pour les atténuer. Si la culture de sécurité dans le secteur de la pêche ne change pas, tout plan de gestion de la fatigue risque d’être ignoré.
Dans des rapports antérieurs du BST, la fatigue a été cernée comme un facteur contribuant aux accidents, et des pêcheurs ont confirmé que les facteurs de risque liés à la fatigue sont répandus dans l’industrie de la pêche commerciale. La présence de facteurs de risque liés à la fatigue dans l’événement à l’étude démontre que la fatigue demeure un problème dans l’industrie de la pêche commerciale.
MESURES À PRENDRE L’enjeu de la gestion de la fatigue dans le transport maritime demeurera sur la Liste de surveillance jusqu’à ce que
|
La surveillance réglementaire figure sur la Liste de surveillance 2022.
Le programme de surveillance de TC n’est pas toujours efficace, tout comme il n’englobe pas l’ensemble des navires commerciaux. Ainsi, le BST continue de voir que les navires canadiens dont la jauge brute ne dépasse pas 15 et ceux transportant 12 passagers ou moins ne sont à peu près pas inspectés, et la LMMC 2001 confie la responsabilité de la sécurité aux RA. Toutefois, de nombreux propriétaires ou RA de petits navires ne possèdent qu’une connaissance limitée des articles clés de la LMMC 2001 ou du cadre réglementaire plus vaste.
Dans l’événement mettant en cause le Tyhawk, les risques liés aux modifications apportées au bateau n’ont été ni reconnus ni atténués, ce qui a contribué à son chavirement.
MESURES À PRENDRE L’enjeu de la surveillance réglementaire dans le transport maritime demeurera sur la Liste de surveillance jusqu’à ce que
|
2.0 Analyse
Le jour de l’ouverture de la saison de pêche au crabe des neiges de 2021 dans le sud du golfe du Saint-Laurent, le Tyhawk a chaviré. Parmi les membres de l’équipage, 3 ont survécu, 1 a été mortellement blessé et le capitaine est toujours porté disparu. L’analyse portera sur les effets cumulatifs de multiples facteurs qui ont entraîné la perte totale de la stabilité du bateau et la perte de vie, ainsi que sur les influences qui s’exercent sur l’acceptation des risques par les pêcheurs. L’analyse abordera également le rôle de la surveillance de Transports Canada (TC) et les processus d’évaluation des risques et de prise de décisions utilisés par Pêches et Océans Canada (MPO) pour la gestion des ressources halieutiques (GRH).
2.1 Perte de stabilité
En cas de perte totale de la stabilité, un navire peut chavirer même sous l’effet d’une faible force. Pendant les opérations de pêche, la stabilité d’un navire change constamment et les conséquences de ces changements peuvent être difficiles à reconnaître. Il est donc essentiel que les capitaines mettent en application des connaissances pratiques en matière de stabilité des navires et soient au courant de la façon dont les différents facteurs compromettent la stabilité.
Parmi les facteurs qui ont eu une incidence sur la stabilité du Tyhawk figurent la construction, les modifications et le chargement du bateau, les conditions environnementales, l’envahissement par le haut et les effets de carène liquide :
- Construction. Les bateaux non pontés tels que le Tyhawk ne sont pas dotés d’un pont étanche et n’ont donc pas de sabords de décharge. Bien qu’ils disposent de dalots pour le lavage du pont (qui permettent à l’eau de s’écouler par-dessus bord), ceux-ci sont fermés en mer et ne peuvent pas être utilisés pour évacuer l’eau pendant l’exploitation. Par conséquent, sans un franc-bord adéquat, les bateaux non pontés sont vulnérables à l’eau qui passe par-dessus les bords et qui s’accumule sur le pont principal et dans la cale.
- Modifications. Les modifications importantes, qui peuvent également comprendre une série de modifications ou de réparations, sont courantes sur les bateaux de pêche. Le pont amovible et la bôme du Tyhawk ont tous deux ajouté du poids au bateau et ont ainsi réduit son franc-bord. De plus, le poids a été ajouté au-dessus du pont principal, ce qui a élevé le centre de gravité du bateau.
- Chargement. Le bateau était chargé de casiers à crabes non arrimés sur le pont amovible ainsi que d’engins connexes et d’appâts sur le pont principal. Ces éléments ont ajouté du poids dans la partie supérieure du bateau, ce qui a eu pour effet d’élever encore plus le centre de gravité du bateau. En outre, le poids supplémentaire a réduit davantage le franc-bord du bateau. Ce chargement a été effectué en s’appuyant sur l’expérience réussie acquise par le passé lors des activités de pêche au crabe des neiges menées à bord du Tyhawk en utilisant le pont amovible. Le Tyhawk n’avait pas fait l’objet d’une évaluation de la stabilité et n’avait donc pas de livret de stabilité. Par conséquent, le capitaine ne disposait d’aucun renseignement supplémentaire sur les limites réelles d’exploitation sécuritaire du bateau pour prendre ses décisions en matière de chargement.
- Conditions environnementales. Le 1er jour de la saison de pêche au crabe des neiges, de la pluie verglaçante s’accumulait sous forme de glace sur la superstructure et les engins et de la pluie s’accumulait sur le bateau, ce qui a eu pour effet d’ajouter du poids au-dessus du centre de gravité et de réduire le franc-bord. Les vagues et le vent se sont intensifiés tout au long du voyage à l’étude, ce qui a également fait passer de l’eau par-dessus les bords du bateau.
-
Envahissement par le haut. Au fur et à mesure que le franc-bord du Tyhawk diminuait et que les conditions environnementales se détérioraient, la quantité d’eau qui passait par-dessus les pavois et qui s’accumulait sur le pont principal et dans la cale augmentait. La stabilité d’un bateau peut être réduite lorsque l’eau s’y accumule sans être détectée. Il est essentiel que toute accumulation d’eau soit détectée sans délai au moyen d’alarmes de cale en bon état de marche placées judicieusement et d’inspections visuelles des endroits où l’eau peut s’accumuler.
L’enquête n’a pas permis de déterminer si les pompes de cale s’étaient activées ou la raison pour laquelle l’alarme de cale n’a pas averti l’équipage de l’accumulation d’eau.
- Effets de carène liquide. Étant donné qu’il s’agit d’un bateau non ponté sans sabords de décharge, le Tyhawk a accumulé de l’eau sur le pont principal sous le pont amovible. L’eau se serait déplacée sur toute la largeur du bateau à mesure que celui-ci avançait. Ce déplacement d’eau aurait exacerbé le mouvement du bateau lui-même au point où celui-ci a gîté sur tribord suffisamment pour que tous les casiers et engins de pêche non arrimés se déplacent également et que le bord du pont soit immergé.
Les rapports d’enquête antérieurs du BST sur des accidents liés à la stabilitéNote de bas de page 96 ont montré que les événements mettant en cause la stabilité (figure 8) sont généralement attribuables à une combinaison de facteurs, comme ce fut le cas pour le Tyhawk.
Faits établis quant aux causes et aux facteurs contributifs
Le pont amovible, les engins non arrimés et l’accumulation de pluie et de pluie verglaçante au-dessus de la ligne de flottaison ont eu pour effet d’élever le centre de gravité du bateau et de diminuer son franc-bord.
Étant donné qu’il s’agissait d’un bateau non ponté, l’eau ne pouvait pas être évacuée des ponts, ce qui a entraîné une accumulation d’eau sur le pont et dans la cale.
Les effets cumulatifs des facteurs liés à la stabilité et les effets de carène liquide qui en ont résulté ont compromis la stabilité du bateau au point où il a chaviré.
2.2 Immersion en eau froide
Les engins de sauvetage assurent la flottaison et protègent contre l’eau froide et les conditions environnementales lorsque les membres d’équipage entrent dans l’eau ou doivent abandonner leur navire. Au moment de l’événement, les températures de l’eau et de l’air étaient proches de zéro, ce qui constitue un grave danger pour la survie.
Le capitaine et l’équipage pêchaient sur le pont sans porter de vêtement de flottaison individuel (VFI). Il s’agit d’une pratique courante sur les bateaux de pêche qui demeure une préoccupation dans les recommandations actives et sur la Liste de surveillance du BST. De plus, lorsque le bateau a fortement gîté sur tribord, l’équipage n’a pas eu le temps d’accéder aux emménagements pour récupérer les gilets de sauvetage ou les combinaisons d’immersion.
Le radeau de sauvetage avait été récemment remplacé, mais il n’avait pas encore été arrimé conformément à la réglementation. Il est donc tombé sous le pont amovible au lieu d’être accessible pour une mise à l’eau manuelle ou de se déployer librement au besoin. Après le chavirement du bateau, la seule possibilité pour l’équipage de rester hors de l’eau était de se tenir sur la partie de la coque renversée qui se trouvait au-dessus de la surface de l’eau.
Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs
Étant donné que les gilets de sauvetage, les combinaisons d’immersion et les VFI n’étaient pas accessibles et que le radeau de sauvetage non arrimé s’était déplacé hors de portée, lorsque le bateau a chaviré, l’équipage a été exposé à l’eau froide sans dispositif de flottaison ni protection contre les éléments, ce qui a contribué à la perte de vie d’un membre d’équipage et à la disparition d’un autre membre d’équipage.
2.3 Fatigue
On sait que la fatigue liée au manque de sommeil et l’inertie du sommeil nuisent au rendement et au fonctionnement cognitif. Les pratiques de travail qui entraînent la fatigue sont un problème connu dans l’industrie de la pêche, tout comme la gestion de la fatigue dans le secteur maritime en général. La sécurité de la pêche commerciale figure sur la Liste de surveillance du BST depuis 2010, et la gestion de la fatigue dans le secteur maritime figure sur la Liste de surveillance du BST depuis 2018.
Les petits bateaux de pêche comme le Tyhawk sont souvent dotés en équipage et aménagés pour être exploités comme des navires de jour; le document sur l’effectif minimal de sécurité du Tyhawk précisait les exigences en matière d’effectif minimal de sécurité pour une exploitation en tant que navire de jour. Cependant, la pêche au crabe des neiges ouvre souvent à minuit Note de bas de page 97, comme c’était le cas en 2021, et se poursuit sans interruption jusqu’à la fin de la saison. En outre, il existe une concurrence pour les lieux de pêche les plus productifs au début de la saison. Par conséquent, la pêche commence dès l’ouverture de la saison afin de maximiser les captures et les profits qui en découlent.
Fait établi : Autre
Dans l’événement à l’étude, le Tyhawk a été exploité de jour comme de nuit sans la présence d’une personne de quart qualifiée supplémentaire, ce qui n’était pas conforme aux exigences d’armement de son document sur l’effectif minimal de sécurité.
Lorsque le bateau a chaviré, le capitaine et l’équipage étaient éveillés depuis environ 34 à 37 heures, ponctuées de seulement quelques siestes nécessaires, mais courtes, de mauvaise qualité et non contrôlées. Avant le voyage à l’étude, ils avaient voyagé de Richibucto (Nouveau-Brunswick) jusqu’à Chéticamp (Nouvelle-Écosse) et avaient effectué un voyage de Chéticamp jusqu’aux lieux de pêche. Leur sommeil au cours de ces 2 jours a été perturbé par les activités liées aux déplacements et à la pêche, ce qui a créé une perturbation aiguë du sommeil.
En outre, ils étaient éveillés pendant leurs creux circadiens, ce qui a contribué aux effets du rythme circadien. Compte tenu du nombre d’heures d’éveil rapporté ainsi que des périodes d’éveil au petit matin et pendant la nuit, les facteurs de risque liés à la fatigue suivants étaient présents : la perturbation aiguë du sommeil, l’état d’éveil prolongé et les effets du rythme circadien. Le capitaine et l’équipage étaient probablement fatigués au moment de l’événement.
Durant une partie du voyage à l’étude, le membre d’équipage 1 assurait le quart à la barre alors que les autres faisaient la sieste en bas pour obtenir le sommeil dont ils avaient besoin. Pendant ce temps, de l’eau s’est accumulée dans la cale du compartiment moteur, sans que le membre d’équipage à la barre s’en aperçoive. Ce membre d’équipage en était à son 3e voyage de pêche et ne connaissait pas bien le fonctionnement du navire et de son équipement. Lorsque le membre d’équipage 2 est arrivé sur la passerelle, on a remarqué la présence d’eau dans le compartiment moteur, et le capitaine et les autres membres d’équipage ont été réveillés rapidement.
Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs
Pour obtenir le sommeil nécessaire, tous les membres d’équipage, à l’exception d’un seul, faisaient la sieste dans les emménagements. Le membre d’équipage qui était à la barre ne connaissait pas bien le fonctionnement du bateau et de son équipement, ce qui, en l’absence du déclenchement de l’alarme de cale, a retardé la détection de l’accumulation d’eau dans la cale du compartiment moteur et sur le pont principal.
L’inertie du sommeil altère les capacités cognitives essentielles de vigilance et de vivacité d’esprit nécessaires à la prise de décisions rationnelles et a probablement affecté le capitaine après son réveil. L’inertie du sommeil a probablement influé sur la décision du capitaine d’ordonner à l’équipage de pêcher plutôt que de chercher la source de l’infiltration d’eau et de reconnaître la détérioration de la situation. De plus, il est probable que le capitaine était encore sujet à l’inertie du sommeil pendant l’abandon du bateau, étant donné le peu de temps qui s’était écoulé depuis son réveil.
Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs
L’inertie du sommeil a probablement eu une incidence sur les capacités du capitaine à reconnaître la détérioration de la situation et sur l’efficacité de l’abandon du bateau.
2.4 Influences sur la perception du risque par les pêcheurs
Les pêcheurs n’évaluent pas le risque indépendamment des autres priorités, et leurs décisions sont influencées par de nombreuses pressions concurrentes. Les risques sont souvent acceptés dès qu’il semble probable que la saison de pêche sera ouverte et que les opérations de pêche commenceront. De plus, le BST a déterminé que certains pêcheurs considèrent que les accidents sont inévitables parce que la pêche est un métier dangereux Note de bas de page 98. Voici certains facteurs qui influencent les décisions des pêcheurs Note de bas de page 99 :
- Il peut y avoir des pressions économiques et communautaires en faveur de la pêche et de la création d’emplois. Ces pressions l’emportent souvent sur toute mesure d’atténuation des risques qui limiterait les possibilités de maximiser les captures, comme le fait d’attendre que les conditions météorologiques soient meilleures pour les opérations de pêche ou d’attendre la lumière du jour.
- La délivrance de certificats et de permis et la réalisation d’inspections de navires par des gouvernements, d’autres organisations et des assureurs peuvent être largement perçus comme une approbation globale.
- Les pêcheurs peuvent se fier à leur confiance en leurs propres compétences, actions et expériences. Il se peut qu’ils ne perçoivent pas la valeur des exigences réglementaires et des éléments connexes, tels que les livrets de stabilité.
- Les années précédentes sans accident renforcent la confiance des pêcheurs quant à la sécurité de leurs activités et, par conséquent, les pêcheurs acceptent sans le savoir les risques réels auxquels ils s’exposent.
Le capitaine a effectué les voyages prévus à 20 milles marins au large de Chéticamp à bord d’un bateau de 13,61 m muni d’un pont amovible, et dans les conditions météorologiques du jour fixé par le MPO pour le début de la saison de pêche au crabe des neiges. Sa perception du risque a probablement été influencée par les éléments suivants :
- Le crabe des neiges est une pêche importante sur le plan économique pour les pêcheurs et la collectivité.
- La saison risquait d’être écourtée en raison des mesures de protection des baleines noires de l’Atlantique Nord.
- Un plus grand nombre de casiers avaient été attribués au Tyhawk d’un autre bateau, ce qui nécessitait davantage de voyages pour les poser.
- Le fait de se rendre sur les lieux de pêche le jour de l’ouverture permettait d’établir la présence des pêcheurs dans la zone la plus productive.
- Le capitaine était titulaire du brevet requis et avait suivi la formation nécessaire.
- Le certificat d’inspection valide délivré par TC ne faisait état d’aucune lacune, et les lacunes qui avaient été relevées précédemment avaient été notées comme étant réglées par l’inspecteur de TC.
- L’inspection d’assurance maritime réalisée en décembre 2020 a permis d’établir que le bateau était en bon état.
- Le permis communautaire annuel a été délivré par le MPO.
- La collectivité a désigné le Tyhawk pour le permis communautaire du MPO.
- Le capitaine comptait 20 ans d’expérience de la pêche au crabe des neiges dans la même zone.
Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs
La perception du capitaine à l’égard du risque lié à l’opération de pêche prévue a été influencée par plusieurs pressions, notamment les incitatifs économiques et communautaires, les approbations et les certificats, ainsi que les expériences antérieures réussies. Par conséquent, le capitaine est parti en direction des lieux de pêche, en croyant probablement que le bateau était stable et bien adapté à la pêche au crabe des neiges.
2.5 Modifications importantes sans évaluation de la stabilité
On modifie un bateau de pêche pour diverses raisons, par exemple pour créer plus d’espace d’entreposage ou de pont en allongeant la poupe ou en ajoutant un pont amovible.
Les modifications importantes, qui comprennent une série de modifications ou de réparations, peuvent nuire à la stabilité et à l’étanchéité à l’eau d’un bateau par rapport à sa conception d’origine. La définition de « modification importante » contient des mots tels que « considérablement » et « incidence », qui sont qualitatifs et peuvent donner lieu à des interprétations différentes. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et ses règlements connexes confient au représentant autorisé (RA) ou au capitaine la responsabilité de décider si ces modifications nécessitent une évaluation de la stabilité. Bien que TC fournisse des lignes directrices aux RA et aux capitaines pour faciliter la prise de cette décision, le respect de ces lignes directrices est volontaire. De plus, ces dernières sont difficiles à utiliser si l’on ne comprend pas bien la notion de stabilité du bateau. Par conséquent, une évaluation systématique de l’ensemble des modifications prévues, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays, peut aider à déterminer celles qui constituent des modifications importantes.
Pour des raisons d’ordre économique, il est également moins probable que les pêcheurs consignent les modifications importantes apportées à leurs bateaux et procèdent à une évaluation de la stabilité. En effet, les évaluations de la stabilité peuvent s’avérer coûteuses et l’Enquête sur les questions de sécurité relatives à l’industrie de la pêche au Canada a permis de révéler que les pêcheurs concentrent leurs dépenses sur des mesures visant à accroître la productivité plutôt que de se préparer à un événement qu’ils estiment peu probable.
Dans l’événement à l’étude, le pont amovible et la bôme étaient en place. Bien que ni le pont amovible ni la bôme n’aient été signalés à TC comme étant des modifications importantes, l’enquête a permis de déterminer que le pont amovible du Tyhawk constituait une modification importante en raison de son poids élevé et de son emplacement. À la suite de l’inspection du Tyhawk par TC en 2013, le pont amovible a été désigné comme une lacune parce qu’il transformait le bateau non ponté en bateau ponté. L’avis de défaut exigeait que le RA fasse remplir et signer un questionnaire sur la stabilité par le capitaine et qu’une évaluation de la stabilité soit effectuée. Toutefois, lorsqu’il a rempli le questionnaire sur la stabilité, le capitaine a indiqué qu’aucune modification ayant une incidence sur la stabilité n’avait été apportée. Compte tenu de la formation et des connaissances du capitaine, de la définition qualitative de « modification importante », et du fait que le questionnaire sur la stabilité pose des questions de nature subjective et sépare les caractéristiques du navire et les facteurs de risque liés à la stabilité, il était peu probable que le capitaine indique qu’une évaluation de la stabilité du Tyhawk était nécessaire.
En 2017, TC a inspecté le bateau sans que le pont amovible soit en place, a noté la lacune comme étant réglée et a délivré un certificat d’inspection. Ce dernier ne contenait aucune note concernant l’utilisation du pont amovible. Par conséquent, le pont amovible et les autres modifications apportées au Tyhawk n’ont pas été évalués par un expert en stabilité pour déterminer leurs effets sur la stabilité, et aucune évaluation de la stabilité n’a été effectuée.
Plusieurs enquêtes Note de bas de page 100 ont permis de repérer des navires auxquels des modifications importantes ont été apportées sans qu’elles aient été signalées. Toutefois, la présente enquête a révélé que les pêcheurs ne comprennent pas toujours en quoi consiste une modification importante. Par conséquent, bien que 17 % des répondants à la campagne d’inspection concentrée de TC aient indiqué qu’ils avaient apporté une modification importante, le nombre réel pourrait être considérablement plus élevé, voire supérieur aux 25 % estimés par TC dans son résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche.
Fait établi quant aux risques
En l’absence d’une définition objective du terme « modification importante », il est possible que les effets d’une modification importante sur la stabilité d’un navire ne soient pas cernés par les RA, les capitaines et TC. Par conséquent, il y a un risque que les navires soient exploités sans disposer d’une stabilité suffisante pour les opérations auxquelles ils sont destinés.
2.6 Niveaux de surveillance et certification de Transports Canada
TC utilise la jauge brute d’un navire pour déterminer le niveau de surveillance et les normes de sécurité qui seront appliqués au navire. Lorsqu’on franchit le seuil de jauge brute de 15, il y a des différences importantes en ce qui concerne le niveau de surveillance et les normes de sécurité qui s’appliquent. L’enquête a permis de déterminer que les pêcheurs peuvent être fortement motivés à maintenir la jauge brute de leurs bateaux en deçà de 15 pour diverses raisons, notamment parce que les exigences réglementaires et la surveillance sont moindres. La répartition des jauges brutes dans le registre des bâtiments, qui fait état d’un grand nombre de bateaux juste en dessous d’une jauge brute de 15, le confirme.
Lorsqu’un nouveau navire est conçu pour avoir une jauge brute de 15 ou moins, la jauge est estimée et l’approbation des plans et la certification par TC ne sont pas requises. Après la construction d’un navire et avant qu’il puisse être immatriculé auprès de TC, la jauge brute doit être calculée ou attribuée afin de remplacer celle estimée à l’étape de la planificationNote de bas de page 101,Note de bas de page 102. Par conséquent, un navire peut être construit conformément à la norme applicable aux navires d’une jauge brute de 15 ou moins, puis inspecté aux fins de certification selon une norme différente si sa jauge brute est supérieure à 15 une fois la construction achevée. L’application ultérieure d’une norme différente peut entraîner une plus grande variabilité des lacunes et des résultats et rendre la conformité à la fois difficile et coûteuse.
Une fois construit, un navire de pêche d’une jauge brute de plus de 15 doit faire l’objet d’une nouvelle certification tous les 4 ans. Les modifications importantes peuvent être coûteuses et nécessiter des coûts supplémentaires pour la certification. Un navire qui nécessite des travaux supplémentaires pour satisfaire aux exigences de certification engendrera des coûts supplémentaires liés aux nouvelles modifications, aux évaluations de la stabilité, aux formalités administratives supplémentaires et à la perte de temps d’exploitation qui en découle.
Les inspecteurs de la sécurité maritime disposent d’une série d’outils de vérification de la conformité pour les aider à faire respecter les normes de sécurité, mais ils doivent faire preuve de jugement professionnel au moment de choisir l’outil qui convient le mieux à chaque situation. Lorsqu’il est confronté à une situation où il est difficile, voire impossible, de se conformer à une norme de sécurité en raison d’une modification apportée aux conditions d’application, chaque inspecteur doit s’efforcer de trouver le meilleur compromis possible pour maintenir les navires en activité. Par conséquent, il y a une grande variabilité dans la certification, y compris l’utilisation de certificats pour une période complète par rapport à des certificats à court terme ou le déclassement des lacunes.
En 2001, la norme du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche qui s’appliquait aux bateaux de pêche d’une jauge brute de plus de 15 était la même que celle du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche, qui a remplacé le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche en 2017. Toutefois, étant donné que la jauge brute du Tyhawk a été estimée en deçà de 15 lors de sa construction en 2001, cette norme n’a pas été appliquée. Par conséquent, il n’existait aucune norme concernant le diamètre précis de l’arbre moteur, la hauteur de la hiloire d’écoutille et l’étanchéité des écoutilles, ni aucune exigence en matière d’écoutille de secours au moment de la construction du bateau. Dix ans plus tard, en 2011, lorsque le bateau a été mesuré en vue de son immatriculation, il s’est avéré que sa jauge brute était supérieure à 15. Lors de l’inspection initiale en 2013, le diamètre de l’arbre moteur et l’écoutille de secours ont été relevés comme étant des lacunes, qui ont été corrigées par la suite. Certaines autres lacunes n’ont pas été notées.
La conformité peut s’avérer difficile lorsque la jauge est mesurée après la construction d’un navire et que des modifications sont apportées par la suite pour satisfaire aux nouvelles normes de sécurité. La variabilité des normes qui ne sont pas respectées, le niveau de risque de non-conformité et l’utilisation des outils d’application de la loi par les inspecteurs de TC peuvent faire en sorte que les inspections de certification aboutissent à des résultats différents. Cette application incohérente des règlements peut accroître le risque pour la sécurité des pêcheurs.
Fait établi quant aux risques
Les normes de sécurité sont fondées sur la jauge brute des navires. En l’absence d’une mesure précise et opportune de la jauge brute, les normes qui s’appliquent à un navire peuvent changer, si bien qu’il est difficile pour les RA de se conformer aux normes de sécurité et pour les organismes de réglementation de les faire appliquer de manière cohérente.
2.7 Gestion des ressources halieutiques pour la pêche au crabe des neiges
Le mandat du MPO est de protéger et de gérer les pêches du Canada, de créer des possibilités économiques pour les collectivités côtières et les pêches, ainsi que de protéger et de restaurer les océans et les écosystèmes marins du Canada. Ce mandat est diversifié et les mesures et décisions du MPO en matière de GRH peuvent avoir une incidence sur la sécurité des pêcheurs en influençant les décisions relatives aux activités de pêche Note de bas de page 103.
Pour prendre des mesures et des décisions en matière de GRH, le MPO évalue les risques économiques, les risques pour la sécurité humaine, et les risques pour les collectivités, les populations de poissons et l’environnement. Dans des situations aussi complexes, les risques doivent être évalués en tenant compte de multiples préoccupations et pressions, y compris les interactions et les effets cumulatifs, afin d’équilibrer les préoccupations en matière d’économie, de conservation et de sécurité. À la première étape de l’évaluation des risques, il faut recenser tous les scénarios pertinents accompagnés de leurs causes potentielles, de leurs facteurs contributifs et de leurs conséquences, en utilisant un large éventail de sources d’information sur les risques, telles que les incidents antérieurs, les avis d’experts et les directives réglementaires.
Dans l’événement à l’étude, le MPO a traité l’ouverture de la saison comme une situation de routine; par conséquent, les risques ont été pris en considération pour une situation qui se produisait souvent dans des conditions semblables. Le protocole relatif à la proposition d’ouverture de la saison prenait en compte l’état des glaces et les conditions météorologiques, en incluant le spécialiste des services des glaces et la Garde côtière canadienne, les considérations économiques, en incluant les pêcheurs et les membres de l’industrie, et les capacités de recherche et de sauvetage, en incluant à nouveau la Garde côtière canadienne. Toutefois, le protocole ne tenait pas compte d’autres dangers et ne désignait pas d’autres experts indépendants, tels que des experts en stabilité et en sécurité des navires. En devançant la date d’ouverture de près de 3 semaines, la pêche se déroulait donc lorsque les températures moyennes de l’eau et de l’air étaient inférieures au point de congélation, augmentant ainsi la probabilité de pluie verglaçante et les risques associés aux conditions météorologiques froides et à l’accumulation de glace. Toutefois, étant donné que la décision d’ouverture de la saison avait été prise couramment au cours des dernières années, elle n’a pas été perçue comme une situation nouvelle et ces nouveaux dangers n’ont pas été cernés comme des sources de risques supplémentaires.
TC est l’organisme de réglementation en matière de sécurité des navires et compte des experts dans ce domaine. TC fournit au MPO une orientation sur les risques et les dangers liés à la construction et à la stabilité des navires, ainsi qu’à la sécurité du personnel. Cependant, lors de la réunion du Comité consultatif de crabe des neiges du sud du golfe du Saint-Laurent, TC a discuté d’un sujet qui ne concernait pas les dangers liés à la pêche au crabe des neiges. TC n’a pas été invité à assister aux réunions sur l’ouverture de la saison du Comité d’établissement de la date d’ouverture de la pêche du crabe des neiges dans la zone 12 (qui est un sous-comité). Par conséquent, TC n’a pas été en mesure de fournir des commentaires en matière de sécurité dans le cadre du protocole du MPO relatif à la proposition d’ouverture de la saison.
De plus, les représentants de l’industrie présents aux réunions d’ouverture de la saison ont fait part de leurs préoccupations et ont communiqué des renseignements sur la sécurité et l’économie. Cependant, les représentants de l’industrie ne sont pas indépendants; toute décision prise aurait une incidence sur leurs revenus ou leurs profits, et ils étaient probablement plus enclins à accepter des risques pour la sécurité que des pertes économiques.
Les politiques et mesures suivantes, pour lesquelles certains dangers n’ont pas été recensés de façon exhaustive, ont eu une incidence sur l’événement à l’étude :
- L’industrie de la pêche participe généralement à la détermination des éventuels ports désignés pour la surveillance des prises et les débarquements. Toutefois, il n’est pas nécessaire que les ports d’attache soient libres de glace à la date d’ouverture de la saison. De plus, la désignation de ports pour la surveillance des prises oblige de nombreux pêcheurs à se déplacer pendant de longues périodes avant l’ouverture de la saison, ce qui a une incidence sur le degré de fatigue des pêcheurs.
- Les politiques de protection de la baleine noire de l’Atlantique Nord (BNAN), qui ont été élaborées dans le cadre d’engagements internationaux et mises en œuvre en 2018, ont raccourci la saison de la pêche au crabe des neiges d’environ un tiers. Les effets d’une saison plus courte sur les revenus des pêcheurs ont été pris en considération et acceptés parce que la situation de la BNAN était urgente, mais cette situation a fait naître une pression pour que la saison commence plus tôt, lorsque les conditions météorologiques sont plus froides et défavorables.
Le sous-comité a suivi le protocole d’ouverture de la saison visant à équilibrer les considérations économiques et la sécurité des pêcheurs et des navires. Toutefois, le protocole d’ouverture de la saison ne tenait compte que du vent et de l’état de la glace sur les lieux de pêche; aucun autre facteur n’était pris en considération. Dans la zone 12 en 2021, les pêcheurs ont dû préparer leur équipement de pêche plus tôt que prévu et dans des conditions météorologiques plus froides que d’habitude. De plus, il y avait de la pluie verglaçante et certains ports d’attache étaient encore bloqués par les glaces, ce qui augmentait les risques d’accumulation de glace et de dommages aux navires. Les températures de l’air étaient également plus froides que d’habitude et il y avait un risque d’immersion en eau froide.
Ces facteurs constituent des risques pour tous les navires, mais plus particulièrement pour les petits bateaux de pêche non pontés. En général, les équipages de ces bateaux sont plus susceptibles de se retrouver dans l’eau où l’immersion en eau froide met leur vie en danger. Toutefois, la taille et la construction des navires ne sont pas prises en compte dans le protocole d’ouverture de la saison. Pour la Première Nation d’Elsipogtog et les autres pêcheurs qui exploitent de petits bateaux, la pêche au crabe des neiges est habituellement leur première pêche de la saison.
Fait établi quant aux risques
Lorsque les mesures et les décisions en matière de GRH ne tiennent pas compte des interactions entre les facteurs économiques, de conservation et de sécurité, y compris leurs effets cumulatifs, il se peut que des décisions touchant des situations nouvelles et complexes soient prises sans que les dangers pour la sécurité aient été convenablement recensés, ce qui accroît les risques pour la sécurité des pêcheurs.
3.0 Faits établis
3.1 Faits établis quant aux causes et aux facteurs contributifs
Il s’agit des conditions, actes ou lacunes de sécurité qui ont causé l’événement ou y ont contribué.
- Le pont amovible, les engins non arrimés et l’accumulation de pluie et de pluie verglaçante au-dessus de la ligne de flottaison ont eu pour effet d’élever le centre de gravité du bateau et de diminuer son franc-bord.
- Étant donné qu’il s’agissait d’un bateau non ponté, l’eau ne pouvait pas être évacuée des ponts, ce qui a entraîné une accumulation d’eau sur le pont et dans la cale.
- Les effets cumulatifs des facteurs liés à la stabilité et les effets de carène liquide qui en ont résulté ont compromis la stabilité du bateau au point où il a chaviré.
- Étant donné que les gilets de sauvetage, les combinaisons d’immersion et les vêtements de flottaison individuels n’étaient pas accessibles et que le radeau de sauvetage non arrimé s’était déplacé hors de portée, lorsque le bateau a chaviré, l’équipage a été exposé à l’eau froide sans dispositif de flottaison ni protection contre les éléments, ce qui a contribué à la perte de vie d’un membre d’équipage et à la disparition d’un autre membre d’équipage.
- Pour obtenir le sommeil nécessaire, tous les membres d’équipage, à l’exception d’un seul, faisaient la sieste dans les emménagements. Le membre d’équipage qui était à la barre ne connaissait pas bien le fonctionnement du bateau et de son équipement, ce qui, en l’absence du déclenchement de l’alarme de cale, a retardé la détection de l’accumulation d’eau dans la cale du compartiment moteur et sur le pont principal.
- L’inertie du sommeil a probablement eu une incidence sur les capacités du capitaine à reconnaître la détérioration de la situation et sur l’efficacité de l’abandon du bateau.
- La perception du capitaine à l’égard du risque lié à l’opération de pêche prévue a été influencée par plusieurs pressions, notamment les incitatifs économiques et communautaires, les approbations et les certificats, ainsi que les expériences antérieures réussies. Par conséquent, le capitaine est parti en direction des lieux de pêche, en croyant probablement que le bateau était stable et bien adapté à la pêche au crabe des neiges.
3.2 Faits établis quant aux risques
Il s’agit des conditions, des actes dangereux, ou des lacunes de sécurité qui n’ont pas été un facteur dans cet événement, mais qui pourraient avoir des conséquences néfastes lors de futurs événements.
- En l’absence d’une définition objective du terme « modification importante », il est possible que les effets d’une modification importante sur la stabilité d’un navire ne soient pas cernés par les représentants autorisés, les capitaines et Transports Canada. Par conséquent, il y a un risque que les navires soient exploités sans disposer d’une stabilité suffisante pour les opérations auxquelles ils sont destinés.
- Les normes de sécurité sont fondées sur la jauge brute des navires. En l’absence d’une mesure précise et opportune de la jauge brute, les normes qui s’appliquent à un navire peuvent changer, si bien qu’il est difficile pour les représentants autorisés de se conformer aux normes de sécurité et pour les organismes de réglementation de les faire appliquer de manière cohérente.
- Lorsque les mesures et les décisions en matière de gestion des ressources halieutiques ne tiennent pas compte des interactions entre les facteurs économiques, de conservation et de sécurité, y compris leurs effets cumulatifs, il se peut que des décisions touchant des situations nouvelles et complexes soient prises sans que les dangers pour la sécurité aient été convenablement recensés, ce qui accroît les risques pour la sécurité des pêcheurs.
3.3 Autres faits établis
Ces éléments pourraient permettre d’améliorer la sécurité, de régler une controverse ou de fournir un point de données pour de futures études sur la sécurité.
- Dans l’événement à l’étude, le Tyhawk a été exploité de jour comme de nuit sans la présence d’une personne de quart qualifiée supplémentaire, ce qui n’était pas conforme aux exigences d’armement de son document sur l’effectif minimal de sécurité.
4.0 Mesures de sécurité
4.1 Mesures de sécurité prises
Le Bureau n’est pas au courant de mesures de sécurité prises à la suite de l’événement à l’étude.
4.2 Mesures de sécurité à prendre
Le 3 avril 2021, alors qu’il se dirigeait vers la zone de pêche au crabe 12 située dans le sud du golfe du Saint-Laurent, le bateau de pêche non ponté Tyhawk, d’une longueur de 13,61 m, a chaviré. À 17 h 44, heure avancée de l’Atlantique, les autorités ont été alertées par un appel passé au service d’urgence 911 par un membre d’équipage. Vers 18 h 34, le bateau de pêche Northumberland Spray est arrivé sur les lieux et a récupéré 4 membres d’équipage. Un membre d’équipage est mort par la suite. En date d’avril 2023, le capitaine était toujours porté disparu.
4.2.1 Définition d’une modification importante
L’enquête a permis de déterminer que la stabilité du Tyhawk avait été compromise en partie par l’ajout d’un pont amovible, dont les effets sur la stabilité du bateau n’avaient pas été évalués. En 2013, Transports Canada (TC) a inspecté le bateau, a émis un avis de défaut en raison du pont amovible et a exigé une évaluation de la stabilité. Le capitaine a rempli un questionnaire sur la stabilité en mai 2015 et a indiqué la présence du pont amovible, mais il n’a pas reconnu que ce dernier constituait une modification qui exigerait une évaluation de la stabilité. L’évaluation de la stabilité exigée par TC n’a pas été réalisée et les documents d’inspection ultérieurs de TC ne mentionnaient pas le pont amovible.
Conformément au Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche, des évaluations de la stabilité sont requises pour tous les nouveaux bâtiments de pêcheNote de bas de page 104 d’une longueur de plus de 9 m et pour ceux qui ont subi une modification importante ou un changement dans ses activités qui risque d’en compromettre la stabilitéNote de bas de page 105. La définition de TC d’une modification importante est la suivante :
… une modification ou une réparation, ou une série de modifications ou de réparations, qui change considérablement la capacité ou les dimensions d’un bâtiment de pêche ou la nature d’un système à bord de celui-ci, ou qui a une incidence sur l’étanchéité à l’eau ou la stabilité de celui-ciNote de bas de page 106.
En ce qui concerne les autres petits bâtiments commerciaux (d’une jauge brute de 15 ou moins) qui ne sont pas des navires à passagers, on trouve une définition semblable de « modification importante » dans le Règlement sur les petits bâtiments. Il incombe au représentant autorisé (RA) de déterminer si une modification est importante.
La définition de « modification importante » (quelque chose qui « change considérablement ») contenue dans le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche et les exigences relatives à une évaluation de la stabilité (quelque chose qui risque de compromettre la stabilité) sont qualitatives et sujettes à interprétation. Bien que TC fournisse des lignes directrices pour aider les RA et les capitaines à cerner les modifications importantesNote de bas de page 107,Note de bas de page 108, les lignes directrices sont qualitatives et exigent une connaissance des principes de stabilité pour être interprétées correctement. Le respect de ces lignes directrices est facultatif. En revanche, les lignes directrices de TC concernant la tenue d’un registre des modifications sont quantitatives et indiquent que les changements de masse de plus de 100 kg devraient faire l’objet d’un suivi.
Dans l’événement à l’étude, le Bureau a conclu qu’en l’absence d’une définition objective de « modification importante », il est possible que les effets d’une modification importante sur la stabilité d’un navire ne soient pas cernés par les RA, les capitaines et TC. Il existe donc un risque que les navires soient exploités sans disposer d’une stabilité suffisante pour les opérations auxquelles ils sont destinés.
Les organismes de réglementation ont un rôle à jouer pour faciliter la détermination systématique des modifications importantes en fournissant des critères précis, mesurables et compréhensibles. Par conséquent, le Bureau recommande que
le ministère des Transports établisse des critères objectifs pour définir les modifications importantes apportées aux petits bateaux de pêche et autres petits bâtiments commerciaux.
Recommandation M23-06 du BST
TC n’exige pas que les RA obtiennent une approbation préalable des modifications prévues ou qu’ils les fassent évaluer, ce qui pourrait également aider à déterminer si une modification risque de compromettre la stabilité. Au Royaume-Uni, en comparaison, les propriétaires de navires de pêche doivent obtenir l’approbation de la Maritime and Coastguard Agency avant d’effectuer des modificationsNote de bas de page 109. Il n’y a pas de compréhension uniforme de ce qui constitue une modification importante pour les petits bâtiments commerciaux au CanadaNote de bas de page 110; il est donc difficile de quantifier l’ampleur réelle de ce problème. Dans son résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié en 2016, TC a estimé que 25 % des navires de pêche feraient l’objet de modifications importantesNote de bas de page 111, tandis que Fish Safe NS a estimé que la plupart des navires de pêche en Nouvelle-Écosse avaient fait l’objet de modifications non déclarées. En outre, les enquêtes du BST ont permis de repérer de façon régulière des navires auxquels des modifications importantes ont été apportées sans qu’elles aient été signaléesNote de bas de page 112.
Bien que les RA soient responsables de la sécurité des navires, TC est responsable de la surveillance réglementaire. Une évaluation systématique menée par une personne compétente de l’ensemble des modifications prévues, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays, peut aider à déterminer celles qui constituent des modifications importantes et la nécessité d’entreprendre une évaluation de la stabilité. La surveillance réglementaire permet à TC d’évaluer les registres des modifications. Étant donné que les petits bateaux de pêche et les autres petits bâtiments commerciaux changent souvent de propriétaire, le fait d’avoir un registre établi des modifications peut aider à garantir que les RA, les capitaines et TC disposent de renseignements complets et à jour lorsqu’ils évaluent la stabilité des navires.
Pour aider les RA, les capitaines et les inspecteurs de TC à vérifier que la stabilité des navires est suffisante, le Bureau recommande que
le ministère des Transports exige que les modifications prévues aux petits bateaux de pêche et autres petits bâtiments commerciaux soient évaluées par une personne compétente, que tous les registres des modifications apportées à ces bateaux soient tenus à jour et que les registres soient mis à la disposition du ministère.
Recommandation M23-07 du BST
4.2.2 Détermination des dangers dans le cadre des décisions relatives à la gestion des ressources halieutiques
Dans l’événement à l’étude, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a devancé la date d’ouverture de la pêche au crabe des neiges de près de 3 semaines par rapport aux années précédentes. Cette décision était fondée sur l’avis d’un sous-comité composé de représentants de l’industrie et du gouvernement. Le MPO et les membres du sous-comité ont traité le choix de la date et de l’heure d’ouverture de la pêche au crabe des neiges de 2021 comme un exercice de routine. Par conséquent, les dangers que présentait le changement de date, qui augmenterait la probabilité d’eau plus froide, de glace et de pluie verglaçante, ou l’ouverture de la pêche à minuit, qui accroîtrait le risque de fatigue, n’ont pas été cernés ou évalués afin de relever leurs répercussions sur la sécurité.
Les décisions relatives à la gestion des ressources halieutiques (GRH) sont complexes, car elles doivent équilibrer les préoccupations en matière d’économie, de conservation et de sécurité, ainsi que leurs interactions et leurs effets cumulatifs. En 2021, la décision d’ouverture de la saison a été influencée par de nombreuses mesures et politiques en matière de GRH. Tous les bateaux de pêche commerciale au Canada, dont le nombre est estimé entre 18 000 et 29 000Note de bas de page 113, sont assujettis à des mesures de GRH qui influencent les actions et les comportements des pêcheursNote de bas de page 114.
Le BST a déjà enquêté sur des événements où des mesures de GRH ont été mises en œuvre et où la sécurité des pêcheurs a été compromise. Par exemple, en septembre 2018, 2 personnes ont perdu la vie lorsque le bateau de pêche Kyla Ann a chaviré près du cap North (Île-du-Prince-Édouard), alors qu’il suivait un corridor défini par le MPO au lieu de la route de navigation établieNote de bas de page 115. En 2016, 2 personnes ont perdu la vie et 2 autres ont été présumées noyées après que l’équipage du Pop’s Pride a navigué dans des conditions de mer défavorables afin de s’assurer que les mesures de GRH étaient respectéesNote de bas de page 116. Le BST a publié en 2012 son Enquête sur les questions de sécurité relatives à l’industrie de la pêche au Canada, selon laquelle la GRH figure parmi les 10 principaux enjeux de sécurité liés aux accidents de pêche. D’après ce rapport, « [l]e fait de se conformer aux mesures de gestion des ressources halieutiques peut aussi amener les pêcheurs à courir des risques » et on y exprime la préoccupation « que les risques pour la sécurité associés aux mesures de gestion des pêches ne soient pas cernés et corrigés convenablementNote de bas de page 117 ».
Les mesures de GRH peuvent avoir des conséquences positives pour la sécurité, indépendamment du fait qu’elles aient été mises en œuvre pour cette raison ou non. À titre d’exemple, dans les régions de la Colombie-Britannique et du Québec, certaines pêches sont limitées aux heures de clarté.
Les décisions complexes, comme celles relatives à la GRH, doivent tenir compte de l’ensemble des domaines et des interactions pertinents et être appuyées par une évaluation complète et méthodique des risques. La qualité d’une évaluation des risques dépend de la rigueur avec laquelle les dangers sont recensés. Pour déterminer le plus grand nombre de dangers possible, tous les renseignements pertinents doivent être examinés par des experts dans leur domaine, y compris des experts indépendants en matière de sécurité qui ne sont pas concernés par les décisions.
Lorsque les mesures et les décisions en matière de GRH ne tiennent pas compte des interactions entre les facteurs économiques, de conservation et de sécurité, y compris leurs effets cumulatifs, il se peut que des décisions touchant des situations nouvelles et complexes soient prises sans que les dangers pour la sécurité aient été convenablement recensés, ce qui accroît les risques pour la sécurité des pêcheurs. Par conséquent, le Bureau recommande que
le ministère des Pêches et des Océans veille à ce que les politiques, les procédures et les pratiques prévoient une détermination exhaustive des dangers et une évaluation des risques connexes pour les pêcheurs lorsque des décisions relatives à la gestion des ressources halieutiques sont prises et intègre une expertise indépendante en matière de sécurité à ces processus.
Recommandation M23-08 du BST
Le présent rapport conclut l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le . Le rapport a été officiellement publié le .
Annexes
Annexe A – Questionnaire sur la stabilité
Source : Transports Canada
Annexe B – Circonstances de l’événement à l’étude qui sont liées aux questions de sécurité importantes relevées dans l’Enquête sur les questions de sécurité relatives à l’industrie de la pêche au Canada (M09Z0001)
| Question de sécurité importante | Faits établis dans le cadre de l’Enquête sur les questions de sécurité relatives à l’industrie de la pêche | Liens avec l’événement à l’étude |
|---|---|---|
| Engins de sauvetage | Les pêcheurs ne tiennent pas toujours des exercices, et certains supposent que la formation, la certification et l’expérience garantissent une réaction rapide en cas d’urgence. | Même si les membres de l’équipage du Tyhawk ne connaissaient pas bien le bateau, aucun exercice de sécurité n’a été réalisé avant l’appareillage. |
| Les pêcheurs équipent parfois leurs bateaux d’engins de sauvetage dans le seul but de se conformer à la réglementation. | Lors du 1er voyage destiné à poser des casiers, le nombre de membres d’équipage à bord du Tyhawk dépassait les limites du radeau de sauvetage. | |
| Les pêcheurs installent et rangent les engins de sauvetage afin de minimiser les répercussions sur les activités de pêche. | Lorsque le Tyhawk a gîté sur tribord, un membre d’équipage a tenté de récupérer les combinaisons d’immersion et les VFI, mais ceux-ci n’étaient pas accessibles. | |
| Formation | Les pêcheurs mènent généralement leurs activités en se fondant sur des connaissances, des compétences et une attitude qu’ils ont acquises principalement au moyen de leur expérience. Les pêcheurs évaluent et gèrent les risques en se basant sur leur expérience. | Alors que les conditions dangereuses s’aggravaient, un membre d’équipage non breveté qui ne connaissait pas le bateau assurait le quart. |
| Certaines associations vouées à la sécurité et commissions d’indemnisation des accidents du travail offrent de la formation à quai et du matériel didactique. | Il n’y a pas d’association œuvrant pour la sécurité de la pêche au Nouveau-Brunswick. | |
| Approche de réglementation de la sécurité | Dans certaines provinces, la commission d’indemnisation des accidents du travail a des politiques qui s’appliquent expressément aux pêcheurs. | La commission d’indemnisation du Nouveau-Brunswick n’a pas de politique concernant les pêcheurs. |
| Seuls les membres d’équipage dont la présence est nécessaire pour satisfaire à l’exigence en matière d’effectif minimal de sécurité sont tenus de suivre la formation sur les fonctions d’urgence en mer. | Parmi les 5 membres d’équipage à bord du Tyhawk au moment de l’événement, 2 seulement avaient suivi une formation sur les fonctions d’urgence en mer. |
Annexe C – Composition du Comité d’établissement de la date d’ouverture de la pêche du crabe des neiges dans la zone 12
Le cadre de référenceNote de bas de page 118 indique que la composition du comité est la suivante :
- 4 représentants des flottilles semi-côtières traditionnelles
- 2 représentants des flottilles côtières traditionnelles
- 4 représentants d’autres flottilles : 1 de chaque province (Nouveau-Brunswick, Québec, Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse)
- 1 représentant de chaque Première Nation
- 2 représentants du secteur de la transformation
- 2 représentants de Pêches et Océans Canada
- représentants de la Garde côtière canadienne
- 1 spécialiste des services des glaces d’Environnement et Changement climatique Canada